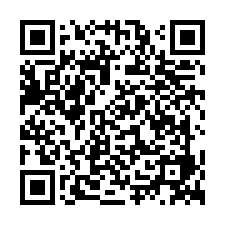6008. Lou Cantoun Prouvençau
La plupart d’entre vous liront directement le texte provençal. Mais pour les quelques autres, une traduction a été ajoutée à ces histoires glanées à droite et à gauche.
Dans le précédent numéro, je commençais le Cantoun en évoquant l’enquête diligentée, en 1807-1808, en vue de recenser les langues traditionnelles utilisées en France. Pour obtenir des renseignements fiables sur notre région, le Sous-préfet de Nyons sollicita deux ecclésiastiques, l’abbé Roux d’Aulan et l’abbé Laugier, prêtre à Ferrassières [1].
Ces phrases patoises
de même que leur traduction en français [2], sont une partie de la réponse que l’abbé Laugier adressa dans une lettre en date du 21 janvier 1808 :
« Quan la terro es en tempouro, la faou trabailla. Prenei garde pereo de la boulegea quau lia que lou dessu de bagna ; aoutramen la dèstempourarias per cinq ou sieys ans. Quau les aoubrès soun en sabo, gardaï vous dé lei rebrounda, aquo lei endéchari.
Quand la terre n’est ni trop molle ni trop dure, il faut la cultiver. Evités aussi de la remuer quand sa surface seulement est mouillée, sans quoi de cinq ou six ans vous n’aurés pas de recoltes. Les arbres étant en seve, gardés vous de les tailler. Cela nuirait à leur pousse.
Si voulès faïre d’ourtoulagi, lichetas la terro, embrisa lei moutos et applannifrès bien lou terren. Quand avès fa vouasto taoulo et que l’ourtoulagi crei, faou arrousa souvent et reclaouré.
Si vous voulez avoir des légumes, bechés la terre, brisés les motes, applannissés bien le terrain. Quand la planche est faite et que le jardinage croit, il faut arroser souvent et entrefouir [3].
Lei faviou craignoun la mascarayo et les choulès les chanillos. Faguei ren surtout que siegué expousa au lévan ; perque vouasté ourtoulagi puesque jouï pu lon tem de l’aiganio et des fresquieros dóu matin.
Les haricots craignent la rouille et les choux les chénilles. Evités surtout l’exposition au levant ; pour que vos végétaux puissent plus longtemps jouir de la rosée et des fraicheurs du matin.
Faou outan dé souins à la vigno : si lo voou agué d’aboundantos recoltos. La faou pouda si es vieillo, din lou darrié quartié de la lune de janvier ; et si es un plantier, din les prumiérs jours de la luno des mars. Lou pouda de febrier faï pourri lei javeous. Lo déou encaro la fouaïré, et chabussa touei les ans per remplaça lei souchos quau peri, faou meme lei déspampa perqué lei rasins se mavuroun miey.
La vigne n’exige pas moins de soins : si l’on veut avoir d’abondantes récoltes, il faut la tailler si elle est vieille pendant le dernier quartier de la lune de janvier ; et si elle est jeune, dans les premiers jours de mars. La taille de février fait pourrir les sarments. On doit encore la piocher, et provigner [4] chaque année pour remplacer les ceps qui ont péri. Il faudrait meme les effeuiller pour que les raisins parvinrent à une plus grande maturité ».
Bon pied, bon œil…et bonne oreille
[raconté par Gilbert Caussade, transcrit par Pierre Mathonnet]
Dous coulego de Mevoulhon semblon countent d’ave ben viei :
— l’un dise « ai encaro uno bono visto, aquesto moumen vese uno fourmigo que mounta lou Ventour »
— l’autre responde « ieu la vese pas mai l’entende marcha »
(deux amis de Mévouillon sont contents d’avoir bien vieilli : – l’un dit : « j’ai encore une bonne vue ; en ce moment, je vois une fourmi qui escalade le Ventoux » – l’autre répond : « moi je la vois pas, mais je l’entends marcher »).
__2__
Suspiciou coumo Sant Glàudi
[Louis Castel – Annales des Basses-Alpes n° 181 – 1942]
De mounte vèn aquelo espressioun : « suspiciou coume Sant Glaudi ? ». Vous lou vòu dire coumo me l’an di :
Dins uno fresquo valèio di Bassis-Aups, anen de Sisteroun a Sederoun, bagnado per lou Jabroun, s’atrobo uno capello dédicado a Sant Glaudi.
Dins aquelo valéio, autres tèms li avié fouosso nouguié : es de segur per aco que l’i’a meme un païs que se li dis Nouguié-sus-Jabroun.
Aqueli nouguié adusien fouosso nòse d’ounte se tiravo un bel òli rous ; aquèu bel òli de nouèi que fasiè tant bouono cousino.
Per ana òu moulin faire l’òli se passavo davans la capello de Sant Glaudi, e èro de tradicioun de leissa en passant douos boutiho d’òli per lou lume de la capello.
Un an, lou Tistet s’entournavo dóu moulin ame sa pausito d’òli dins de flasquou qu’avié ben cala dins leis ensari de soun ase, e aviè mes, coumo se devié, douos boutiho de cousta per lou lume de Sant Glaudi. Mai coumo la recordo ero pas estado tròu bouono e qu’ero un pòu ladre, li fasié regrès de leissa aquelei douos boutiho.
Dóu tèms que l’ase rousigavo uno cardeletto, mange un moucèu de pastèu e s’amourre par bèure un cop à la fouont ; au moument de parti prengué lei douos boutiho, lei regardé bèn, puèi lei remetté dins leis ensari, en diguent a Sant Glaudi : « vesès que n’ai pas fouosso aquest’an, dins quauque tèms vous n’adurai un pòu d’aquèu de l’an passa ; es bèn un pòu ranci, mai per lou lume tant vous fara. »
Sa counscienci un pòu en repau parté.
Ague pa enca fa mièjo lègo, que vai te fa foutre, l’ase s’embrounqué, e se garcé par lou sòu ; lei flasquou se roumpéroun e resté plus en aquèu paure Tistet uno souleto gouto d’òli.
Aquèu paure malurous se derabavo lei chavu en renant coum’un pouor malau, e planten aqui soun ase, s’entourné en courrent jusqu’a la capello ounte avié manca a soun dévé, per sarca garouio a Sant Glaudi qu’acusavo de l’i agué juga aquèu tour per se venja dei douos boutiho.
Quouro arribe davans la capello, garce soun capèu per lou sòu en lou chòupinan, que la rabi l’estoufavo, e passèn sa testo d’un fenestroun, cridé coum’un dana òu bèu Sant Glaudi, que, èu, boulegavo pas :
« Sant Glaudi !… Sant Glaudi !… òurièu jamai cresu que siéguessas tant suspiciou !!!… »
[D’où vient l’expression « suspicieux comme Saint Claude » ? Je vais vous le dire, comme on me l’a raconté : dans une fraîche vallée des Basses-Alpes, qui va de Sisteron à Séderon, baignée par le Jabron, se trouve une chapelle dédiée à Saint Claude.
Dans cette vallée, il y avait autrefois beaucoup de noyers ; c’est certainement la raison pour laquelle il y a un village qui s’appelle Noyers sur Jabron. Ces noyers donnaient beaucoup de noix dont on tirait une belle huile rousse, de cette belle huile de noix qui faisait la cuisine si bonne. Pour aller au moulin faire l’huile, on passait devant la chapelle de Saint Claude, et il était de tradition de laisser en passant deux bouteilles d’huile pour les lampes de la chapelle.
Une année, le Tistet revenait du moulin avec sa production d’huile dans des flacons qu’il avait bien calés dans les couffins du bât de son âne et il avait mis, comme il le fallait, deux bouteilles de côté pour la lumière de Saint Claude. Mais comme la récolte n’avait pas été trop bonne, et qu’il était un peu ladre, ça lui faisait peine de laisser ces deux bouteilles.
Pendant que l’âne rousiguait un petit chardon, il mange un morceau de pasteu et se penche pour boire un coup à la fontaine ; au moment de repartir, il prend les deux bouteilles, les regarde bien puis les remet dans les couffins en disant à Saint Claude : « voyez, je n’en ai pas beaucoup cette année, dans quelque temps je vous donnerai un peu de celle de l’an dernier ; elle est bien un peu rance, mais pour faire de la lumière, tant ça vous fera. »
Il part, sa conscience un peu en repos. Il n’avait pas encore fait une demi-lieue que, va te faire foutre, l’âne s’embronche et se fout par terre ; les flacons se brisent et ne reste plus une seule goutte d’huile au pauvre Tistet.
Le pauvre malheureux s’arrachait les cheveux en râlant comme un cochon malade. Abandonnant là son âne, il retourne en courant jusqu’à la chapelle où il avait manqué à son devoir, pour chercher dispute à Saint Claude qu’il accusait de lui avoir jouer ce tour pour se venger des deux bouteilles.
Quand il arrive devant la chapelle, il jette son chapeau au sol et le piétine, tellement la rage l’étouffait, et passant la tête par un fenestron il crie comme un damné au beau Saint Claude qui, lui, ne bougeait pas : « Saint Claude ! Saint Claude ! je n’aurais jamais cru que vous soyez si suspicieux !!! ».]
__2__
Quelques proverbes séderonnais printaniers
[Pierre Mathonnet]
— Quand l’auro branto lou Rameu, branto jusquo la San Micheou
— Lou mes de mai n’a trent’un se n’en plouguesse trente farié de mau à degun.
— A la Semano Santo lou couguieu canto.
__2__
Souvenir du planteur de Caïffa
[Marie Mauron]
Née en 1896 à St Rémy de Provence, Marie Mauron s’était fait une belle place dans la littérature. Elle obtint, entre autres nombreuses récompenses, le Grand prix littéraire de Provence pour son livre bilingue Quouro la vido èro la vido – Lorsque la vie était la vie [1971 – Pierre Rollet, éd. Ramoun Berenguié].
Ce livre de souvenirs raconte le temps où l’auteur était une petite fille, vivant dans le mas paternel au pied des Alpilles, quand l’agriculture d’avant la mécanisation rythmait la vie de la Provence. Il nous offre, en écho à l’article d’Hélène Andriant dans le précédent numéro, un authentique témoignage sur l’implantation des produits du Planteur de Caïffa :
« Au mas, lou massapan garni de sa grano requisto, se metié pèr aro sus lou mantèu de la chaminèio. L’on butavo pèr ié faire plaço, li pot de faïenço que disien en francès : farine, sel, café, thé, poivre, safran.
Parlavon pas coume nous-autre aquéli franciot, amor qu’èron uno primo dóu Planteur de Caïffa. Sa soulo fantasié venié de ço que la farino èro jamai dins lou pot à soun noum, lou cafè nimai que l’on metié dins aquéu, plus grand, pèr lou sucre. Lou plus pichoutet, aquèu dou safran, i’avié toujour li clavèu fin dedins. »
[« au mas, le massapan garni de sa précieuse graine [5] se mettait alors sur le manteau de la cheminée. Pour lui faire place, on poussait les pots de faïence sur lesquels était écrit en français : farine, sel, café, thé, poivre, safran.
Ils ne parlaient pas comme nous ces franciots [6], puisqu’ils étaient des primes du Planteur de Caïffa. Leur seule fantaisie venait de ce que la farine n’était jamais dans le pot à son nom, le café non plus que l’on mettait dans celui, plus grand, destiné au sucre. Le plus petit, celui du safran, contenait toujours les petits clous fins. »].
[7]