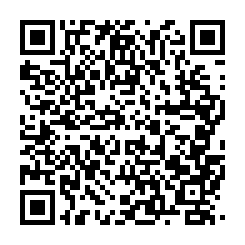Si les quelques lignes suivantes, consacrées au métier de maçon à Séderon sous l’Ancien Régime, ont une certaine originalité c’est principalement parce que ce métier s’approvisionne localement en matériaux de construction. Cette autarcie caractérise la plupart des activités artisanales pratiquées à Séderon à cette époque.
C’est de cette manière que des maçons séderonnais ont par exemple :
- construit, dans la deuxième moitié du XVIIᵉ siècle, les deux chapelles latérales de l’église paroissiale de Séderon, après percement des murs de la nef d’origine,
- aménagé en 1708, au-dessus du four à usage collectif (où le seigneur prélève son droit de cuisson du pain), un étage destiné à abriter les assemblées des chefs de famille de Séderon et fournir une salle de classe pour les enfants des écoles,
- refait en 1712 un pont en dos-d’âne, situé à l’emplacement de l’actuel plus bas pont, pour sécuriser l’accès à Villefranche (par le chemin du Rieu) ou à Vers (par le chemin de Vinigière).
Le métier de maçon.
Un certain nombre de prix-faits (devis de maçonnerie) établis devant notaire permettent d’imaginer le travail des maçons séderonnais sous l’Ancien Régime.
À l’époque le maçon se charge non seulement de la construction des murs en pierres et mortier de chaux (2/3 de sable de rivière, 1/3 de chaux) mais aussi de la pose de la charpente et de la couverture en tuiles, de la mise en place des huisseries, de la réalisation des planchers et des aménagements intérieurs (cloisons, escaliers, cheminées, etc) en briques de terre cuite (cairons) et en plâtre.
En général, les prix-faits prévoient le partage des matériaux et des tâches entre le maçon et le commanditaire. Dans un de ces devis, le maçon sera tenu des murailles et du couvert et le commanditaire fournira les poutres et rien de plus, dans un autre il est prévu que la pierre nécessaire sera arrachée conjointement par le commanditaire et le maçon, que le sable, les tuiles et le bois seront fournis par le commanditaire, la chaux et le plâtre par le maçon.
Le commanditaire fournit pratiquement toujours le bois de construction puisque c’est à lui seul que le seigneur, propriétaire des bois, peut accorder l’autorisation de couper des arbres entiers. C’est sans doute à cause de ce droit seigneurial que les maisons anciennes de Séderon possèdent de beaux linteaux en pierres de taille assemblées en arc de cercle plutôt que des linteaux en bois.
Comme il est précisé dans un prix-fait de 1774, le plancher dans les maisons séderonnaises de l’époque est construit sur des poutres soit en planches jointées, soit plafonné et corroiné en briques par bon mortier, c’est-à-dire en carreaux de terre cuite (mallons) posés sur un corroi (battu de mortier) et des quartons (soliveaux obtenus en fendant en quatre une pièce de bois dans sa longueur).
Le commanditaire participe parfois aux travaux des maçons. En 1774, dans un prix-fait correspondant à environ 13 semaines de travail, un maçon séderonnais demande à son commanditaire de luy aider une semaine avec ses mules. Mais le plus souvent le maçon se fait aider par des travailleurs (petits paysans) qui font le maçon (c’est-à-dire le manœuvre) pour se procurer des ressources d’appoint. En 1789, deux habitants de Villefranche sont qualifiés de travailleurs et maçons dans un acte notarié passé à Séderon.
Les modalités de paiement, qui figurent dans le prix-fait, prévoient en général trois versements : environ 1/3 du montant du devis à la commande, environ 1/3 du montant du devis à moitié œuvre et le surplus dès que l’ouvrage aura été recepté.
En 1771, un maçon séderonnais se fait payer 26 sols (environ 52 euros) pour une journée de travail et, à l’époque de la Révolution, il demande :
- 230 livres (environ 9200 euros) pour la construction des 4 murs et la pose de la toiture d’un bâtiment de 21 m² de surface au sol et de 5 m de hauteur,
- 150 livres (environ 6000 euros) pour la réalisation de 2 planchers et la pose de la toiture d’un bâtiment de 98 m² de surface au sol,
- 150 livres pour la construction d’un escalier et d’une cheminée.
Une partie du paiement peut s’effectuer en nature : dans le prix-fait de 1774, le maçon réclame une charge de vin (64 litres), soit environ 5 litres de vin par semaine de travaux.
Sans doute parce que les maçons de l’époque devaient se faire autant attendre que ceux d’aujourd’hui, dans les prix-faits le commanditaire exige du maçon de s’engager sur une date de fin des travaux.
Le devis de réfection du plus bas pont en 1712 permet de retrouver les techniques de maçonnerie employées pour ce type de travaux importants :
- faire les sindres, coffrer la voûte à l’aide d’un cintre de bois, étançonné sur les rives,
- brocher les cantouns, tailler les pierres pour bâtir sur les rives les socles d’appui de la voûte,
- faire la massonerie de chaussine et sable, construire la voûte en pierres de taille liées au ciment de chaux,
- dessindrer, déposer le cintre une fois la voûte terminée et le ciment séché,
- refaire le pavé, remplir le dessus de la voûte avec de la terre et poser un tablier.
L’approvisionnement en pierres de construction.
Les pierres de construction proviennent généralement de l’épierrage des champs. Les pierres de taille nécessaires à la construction des angles de mur, des piédroits et des linteaux d’ouverture sont tirées de carrières locales comme l’indique clairement le verbe arracher employé dans le devis cité précédemment. Les pierres de taille sont certainement tirées d’une carrière commune située à l’Essaillon (en vieux français le terme échaillon, qui a pour variante provençale essaillon, désigne un lieu rempli de pierres). Dans l’état de sections du premier plan cadastral de Séderon, la parcelle où se situe la carrière est attribuée à la Commune de Séderon. D’après un document de 1703, la carrière est déjà en exploitation (à cette date, des particuliers qui ont fait tirer des pierres sont poursuivis pour avoir endommagé le pas de l’essaillon en les roullant). L’emplacement de la carrière est encore bien visible à l’heure actuelle, dans le flanc de la colline de la Tour, au lieu-dit la Carrière, en face du plus bas pont. Des observations géologiques actuelles montrent que les couches rocheuses exploitées sont formées de calcaire massif à grains très fins (calcaire du Tithonien) qui fournissent un excellent matériau de construction. La carrière se situe en limite du quartier qui déjà à l’époque porte le nom de Sainte-Barbe (cité en 1700) sans doute parce qu’un petit oratoire dédié à cette sainte y est érigé. Il est alors permis de supposer que la pierre était arrachée à l’aide d’explosif et que les maçons pratiquant cette technique se plaçaient sous la protection de Sainte-Barbe, patronne des artificiers. Cette technique ancienne consistait à introduire dans un trou foré une charge de poudre noire, une mèche d’allumage et une bourre de débris de pierre.
L’approvisionnement en chaux.
À l’époque à Séderon, comme dans toute la Haute Provence, la chaux est fabriquée localement par calcination du calcaire (carbonate de calcium). Les meilleures pierres à chaux utilisées comme matière première sont les blocs calcaires de couleur gris bleuâtre veiné de blanc qui se trouvent en abondance sur le territoire de Séderon.
Le four à chaux utilisé est une installation rudimentaire, ne servant qu’une fois. Il se présente généralement sous la forme d’une cavité cylindrique verticale d’environ 3 à 4 m de profondeur, pratiquée dans un talus afin de pouvoir réaliser par creusement à sa partie inférieure une ouverture servant au tirage et à l’alimentation en combustible. Le diamètre de la cavité devait être suffisant pour qu’un homme puisse y descendre. L’intérieur de la cavité est tapissé d’argile puis rempli de pierres à chaux. En partie basse de la cavité, celles-ci sont rangées pour former une voûte au-dessus d’un espace servant de foyer. Une fois rempli, le four est recouvert d’une couche de terre servant d’isolant dans laquelle sont pratiquées des cheminées pour l’évacuation des gaz chauds. La calcination dure environ 3 jours et 3 nuits pendant lesquels le foyer est constamment alimenté en fagots pour maintenir le four à une température voisine de 1 000 °C. Après un tel traitement, le four à chaux devient inutilisable. Les pierres à chaux cuites sont alors récupérées et gardées dans des récipients à l’abri de l’air.
La chaux est vendue en blocs aux maçons qui la transportent ainsi sur leurs chantiers. Pour l’utiliser, les maçons humectent les blocs avec un peu d’eau, ce qui provoque un fort dégagement de chaleur qui les fragmente. La chaux est ensuite transformée en pâte par trituration dans un excès d’eau, puis mélangée à du sable de rivière pour donner le mortier de chaux.
Il semble que la chaux soit à l’époque fabriquée par des travailleurs séderonnais qui trouvent ainsi une ressource d’appoint mais ne possèdent pas toujours la technicité requise. De nombreux fours ne réussissent pas par le meschant gouvert de ceux qui les entreprennent. Au début du XVIIIᵉ siècle il est signalé qu’à Séderon il s’est fait depuis dix à douze années plus de vingt fours qui n’en a pas réussi deux.
L’approvisionnement en plâtre.
En Haute Provence jusqu’au milieu du XIXᵉ siècle, ce sont généralement les maçons qui fabriquent eux-mêmes le plâtre dont ils ont besoin à l’endroit même de leurs chantiers de construction ou de réparation. Dans un prix-fait établi à Séderon à l’époque de la Révolution, il est ainsi spécifié que le maçon cuira et fournira le plâtre.
Cette décentralisation de la fabrication du plâtre est sans doute la conséquence de sa faible consommation en bois de chauffage. La fabrication du plâtre (lou gip en provençal) ne nécessite en effet qu’une déshydratation du gypse (sulfate de calcium hydraté) à une température de l’ordre de 150 °C. Les fourneaux mis en œuvre pour la fabrication du plâtre ne servent qu’une fois. Pour leur construction, les plus gros fragments de gypse sont disposés sous la forme d’une voûte d’environ 1 m, puis les fragments plus petits sont rangés sur celle-ci de façon à ménager des interstices. Un feu de bois est alors allumé sous la voûte et après 2 à 3 heures de cuisson, les fragments de gypse sont triés (pour éliminer ceux qui sont trop ou pas assez cuits) puis broyés à l’aide d’une masse en bois.
Ce mode de fabrication est généralement utilisé à l’époque en Haute Provence où certaines Communautés possèdent des mines de gypse importantes (Clamensane, Digne, Lazer, Mane, Manosque, Upaix).
Avec ce mode de fabrication, le maçon ne prépare que la quantité de plâtre dont il a besoin et ne court pas le risque de voir celui-ci s’éventer en le stockant trop longtemps dans des sacs qui à l’époque n’avaient sans doute pas une qualité suffisante pour le mettre à l’abri de l’humidité ambiante.
Ce mode de fabrication permet également de recycler les plâtres récupérés lors des démolitions. Un prix-fait passé à l’époque autorise le maçon à prendre tous les vieux platres inutiles, les recuire et s’en servir.
Les maçons séderonnais de la fin de l’Ancien Régime semblent surtout s’approvisionner à la mine de plastre située au quartier des Testes, en dessous Gueisset. Cette mine ancienne a été recreusée en 1690 aux frais de la Communauté de Séderon, à un endroit où en 1688 des habitants de Séderon avaient déjà creusé et où ils avaient eu apparence d’en trouver. La mine est sans aucun doute encore visible à l’heure actuelle sur le flanc Sud-Ouest de la colline au sommet de laquelle se situeraient les ruines de Gueisset. Elle se présente sous la forme d’une longue excavation, d’environ 50 m de long, 20 m de large et 5 m de profondeur. L’excavation, perpendiculaire à la pente et d’une profondeur pratiquement constante, n’a manifestement pas été creusée par l’érosion. La forme de l’excavation correspond aux descriptions sommaires de la mine données à l’époque (un fossé en 1688, un canal en 1690). La profondeur de l’excavation correspond également à la profondeur donnée en 1690 (deux cannes, soit environ 4 m). L’accès au gisement de gypse semble avoir été facilité par l’existence d’une faille dans les couches de calcaire superficielles. Le nouveau creusement de la mine de plastre en 1690 a été effectué sur les conseils d’un homme de Montbrun, sans doute parce que l’extraction du gypse semble être à l’époque une spécialité des habitants de ce village (elle a donné son nom au quartier des Gypières) et parce qu’elle se fait sous les mêmes couches de calcaire qu’à Gueisset (calcaire du Hauterivien).
Pour terminer ces lignes il convient peut-être de les illustrer en citant quelques personnages qui ont exercé le métier de maçon à Séderon avant la Révolution :
Les actes notariés signalent également quelques étrangers, comme qui semble résider durablement à Séderon (la Communauté lui paye des travaux de réparation entre 1775 et 1785).
- au XVIIIᵉ siècle, le maçon Joseph Morier fait partie des chefs de famille séderonnais,
- le seul maçon recensé en 1790 est le chef de famille Jean-Antoine Faure, originaire de Moydans venu s’installer à Séderon en 1770,
- à cette date, l’aubergiste Joseph Dumont semble exercer à temps partiel le métier de maçon et laisser peut-être pendant ce temps à son épouse le soin de la gestion de l’auberge (il est plusieurs fois qualifié de maçon dans les registres paroissiaux et les outils de maçon sont mentionnés dans l’inventaire de son mobilier),
- entre 1775 et 1785, des travaux de réparation sont confiés au maitre maçon italien Jean-Pierre Violina.
Pierre MATHONNET