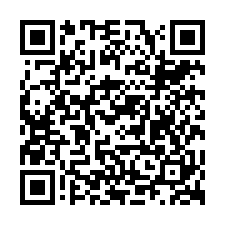1618
Henri IV a été assassiné le 14 mai 1610. Louis XIII, à peine âgé de 8 ans, succède aussitôt à son père selon l’adage « le Roi est mort, vive le Roi ». Il n’épousera Anne d’Autriche que le 25 novembre 1615 à Bordeaux. Marie de Médicis, sa mère, exercera la Régence jusqu’en 1617.
Au plan religieux, Henri IV a pacifié la France par la signature de l’Édit de Nantes en 1598 après une succession de 8 guerres de religion qui ont divisé le pays. Sous l’Ancien Régime, Séderon appartient à la Provence, dépendant du Parlement d’Aix. Les « députés de la communauté » iront souvent à la viguerie de Forcalquier.
On recense 13 délibérations dans les registres consulaires pour l’année 1618.
La première se tient le 17 janvier. Elus lors de l’assemblée du 26 décembre 1617, les consuls Anthoine RICOU et Anthoine GRANCHAN convoquent le conseil au sujet du ministère de « ceux de la religion réformée ». Une lettre est lue de la part du “prieur” du lieu informant que les protestants du village ont fait venir un « ministre pour y prêcher » et « exhortant chacun de vivre en paix et union » et respecter les ordres, édits et ordonnances du roi. « Sur quoi a été délibéré – tous unanimement – de vivre en bonne union et en paix (…) et chacun se range à la volonté du roy ».
Le 6 mars les consuls exposent les affaires en cours : un apothicaire propose de s’installer dans le village mais… contre rétribution, la sage-femme ne veut plus occuper sa charge, des créanciers (hôpital de St-Savournin, le sieur Thomé) veulent être remboursés et les habitants se plaignent du meunier qui gère le moulin comme s’il lui appartenait alors qu’il n’en est que le locataire… Les membres de l’assemblée décident « pour ledit apothicaire que s’il veut venir habiter : qu’on en est bien aise et que pour luy donner, [ils] ne le peuvent faire ». En ce qui concerne la sage-femme, les consuls sont chargés d’en trouver une autre. Pour les dettes, il est préconisé de poursuivre les actions de la communauté devant la cour afin d’avoir un report. Pour le meunier, « il sera sommé de bien et fidèlement servir et observer toute occasion de plainte » au risque de se voir retirer la charge du moulin…
Le 10 juin, les consuls rapportent à l’assemblée que Charles Bonnefoy et Alizette Moffier sa mère, héritiers de Nicolas Moffier « en son vivant prieur » de Séderon les ont informés que ce dernier a légué 100 florins [3] dans son testament à l’église du village. Les consuls sont donc chargés de recueillir cette somme et d’en donner quittance à Charles Bonnefoy.
Le 24 juillet, Jehan Degenin, trésorier de la communauté rend ses comptes pour l’année 1617 : on compte 1763 écus et 30 sols de rentrées et 1905 écus et 23 sous et demi de dépenses, comprenant la rémunération de sa charge de trésorier de 150 écus. Avec le reliquat de la trésorerie de 1616, la communauté se trouve débitrice de 141 écus et 53 sous…
Le 29 juillet, les consuls rappellent à l’assemblée que l’hôpital de St-Savournin exige le paiement des dettes de la communauté. Il est décidé d’envoyer un représentant du village pour “négocier” les conditions du remboursement… Il est aussi exigé de la communauté qu’elle paye les réparations du pont du Jabron qui se montent à 6 écus : pour ce faire, les consuls sont chargés de vendre le blé du moulin. Pour rembourser une partie des dettes de la communauté, l’assemblée valide la demande du trésorier de lever une nouvelle imposition de 6 écus. Enfin, il est décidé de trouver un nouveau maître d’école ou de « rappeler Me Clauson aux gages accoutumés » sans que ces gages ne soient payés par les protestants du village car ils ont leur propre maître d’école…
Le 30 août, le conseil délibère sur les pluies torrentielles qui ont détruit les récoltes : « que par la tempête qui est survenue ces jours passés, ayant été péri presque la moitié des fruits desdits habitants. D’ailleurs, que pour l’injure du temps, on ne peut retirer à couvert le peu de reste de leurs susdits fruits qui sont encore aux champs, à cause des pluies et inondations d’eaux qui règnent – qu’il semble que Dieu soit provoqué à ire [4] à cause des péchés du peuple – et que pour apaiser le courroux de Dieu, [il] serait à propos et très nécessaire de se mettre en prières extraordinaires, faire des jeûnes et aumônes et autres œuvres pies et charitables et à ces fins que chacun fût admonesté à cesser de leurs œuvres manuelles, pour vaquer auxdits exercices de piété. Sur quoy a été délibéré qu’il sera fait un jeûne par trois jours, commencé ce jourd’huy, au pain et à l’eau seuls, de s’assembler extraordinairement pour faire prières durant lesdits trois jours ; avant [de] se mettre en aucun travail manuel chacun s’exercera en pies œuvres de piété et charité, même envers les pauvres, chacun selon sa faculté et bonne intention, à ce que par tel vœu Dieu soit apaisé et ait pitié du peuple ».
Les consuls abordent aussi l’absence du curé : « attendu l’inconstance de M[essir]e Bayet curé qui ne cesse de voyager, quittant le peuple mourant, souvent. Des personnes sans assistance de lui, étant souvent contraintes de mander appeler des prêtres ailleurs, pour faire des baptêmes. Bref (…), vu quil ne s’acquitte aucunement de son devoir – au grand escandalle du peuple – qu’il serait à propos de mander au Sr prieur de ce lieu de l’ôter de ladite cure et leur en pourvoir d’un autre ; et à son reffus, de se retirer par devers l’evêque ».
Les consuls évoquent également la situation du maître d’école : « Me Plausin ne s’acquitte meilleurement de son devoir à la charge de régent et que s’il ne fait autrement, a été proposé de le congédier ».
Le 16 septembre, la charge de « fournier pour le four à cuire le pain » est mise aux enchères à partir de la Saint-Michel pour un an. La rémunération est « d’un pain pour quatre-vingts qui se cuiront audit four » et le fournier « pourvoira de bois nécessaire, à ses dépens pour cuire ledit pain ». C’est Anthoine Granchan, fils de Guillaume, dernier enchérisseur, qui occupera cette charge.
Enfin, pour réparer la fontaine et le pont de la fuste, il faut payer 20 écus : un nouvel impôt, “cappage”, est donc levé « par les consuls assistés de un ou deux des conseillers (…) selon la faculté et capacité d’un chacun habitant, exigible par le trésorier moderne ».
Le 30 septembre, les consuls informent qu’il faut régler la taille et le taillon à la viguerie de Sisteron, ainsi que la rémunération du maître d’école, M. Clauson, mais qu’ils n’ont « nul moyen en main »…
Le 10 novembre, rappelle qu’il faut apporter 35 écus à la viguerie de Sisteron et qu’ils n’ont « aulcun moyen de y satisfaire ». Il est donc décidé de vendre du blé du moulin « à la meilleure condition que se pourra »…
Le 10 décembre, suite à la saisie de récoltes intervenue, le juge déclare : « comme on ne peut ignorer de la violence qui est intervenue ces jours passés, sur la prise de blé du prieuré dudit lieu, sur la nuit, sans qu’il y ait eu aucune forme d’opposition et que par l’avenir on pourra encourir les mêmes oppressions, même chacun en particulier. Et que ce n’est ainsi qu’il y faut procéder et qu’on se doit mieux mettre en devoir, pour se défendre et maintenir les uns les autres par l’avenir, ce qu’on n’a fait par le passé ». Il est ainsi décidé par l’assemblée « que lorsqu’arrivera quelque oppression, soit sur le général ou particulier dudit lieu, de s’y opposer et l’empêcher en tant que faire se pourra, étant néanmoins assistés de la justice et que à effet, les consuls feront assembler le conseil général ».
Il est aussi décidé d’obliger les habitants présents dans le village à assister aux assemblées de la communauté sous peine de se voir infliger une amende de 10 sous.
Enfin, pour tenter de trouver des solutions avec certains créanciers (hôpital de St-Savournin et autres), le conseil donne procuration aux consuls Anthoine Ricou et Anthoine Granchan assistés de Jehan Bonnefoy, Pierre Jean, Anthoine Reynaud, Pierre Ricou et Pierre Robaud « d’accomoder lesdites affaires et payer les arriérés à la meilleure condition que faire se pourra »…
Le 26 décembre, comme chaque année, on procède à l’élection des consuls pour l’année suivante. Sont donc élus pour l’année 1619 : Pierre Chastel fils de Pierre comme premier consul et Esteve Laurent comme deuxième consul. Sont nommé pour experts et estimateurs les consuls précédents : Anthoine Ricou et Anthoine Granchan dit « consuls vieux ». Ils ont ensuite prêté serment entre les mains du baille et ont « promis de bien et fidèlement s’acquitter de ladite charge et ont le chacun d’eux signé qui a su écrire, avec ledit baille ». Les nouveaux consuls sont aussi élus recteurs de l’hôpital…
Nous verrons ce qu’il en est en 1619.