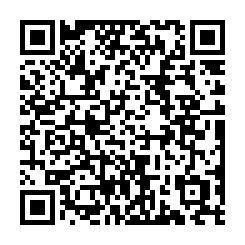2° partie : Les affections et les curistes
A la fin du XIX° siècle, Montbrun-les-Bains est cependant connu pour ses « sulfureuses froides ». En 1874, l’établissement thermal propose l’administration des eaux en boissons, douches laryngiennes, faciales et oculaires, en pulvérisation et inhalation gazeuses, et dispose de logements pour 100 malades.

|

|
L’établissement thermal sera fermé en 1913 pour causes circonstancielles : la première guerre mondiale entraînera, entre autres événements, la désertion des cures thermales…
Nature de l’activité thermale
Aux XVIIIe et XIXe siècles, les eaux « froides » de Montbrun-les-Bains sont surtout réputées pour le traitement des affections respiratoires, ainsi que pour le traitement des affections de la peau.
En 1874, l’établissement thermal de Montbrun-les-Bains propose « ’expédition, contre remboursement, par caisses de 50 et 25 bouteilles demi-litres et quarts de litres, pour l’emploi en boisson, en douches oculaires, laryngiennes et faciales ». C’était déjà le cas en 1864 d’après le bilan financier ci-dessous.
| Nombre de bains donnés :
Nombre de douches données : Nombre de malades payants la buvette : Baigneurs inscrits : |
2 100
330 470 600 | |||
| Recettes | Dépenses | |||
| Bains aux indigents | 290 | 0.00 | Impositions | 100.00 |
| Bains payés | 2 410 | 2 410.00 | Couleur aux baignoires | 70.50 |
| Douches indigents | 70 | 0.00 | Réparation aux tuyaux robinets | 130.00 |
| Douches payées | 260 | 260.00 | Blanchissage des cabinets à la chaux | 60.75 |
| Buvette non payants | 193 | 0.00 | Frais des garçons de bain | 450.00 |
| Buvette payants | 407 | 814.00 | Buanderie | 85.50 |
| Expédition de 26 bouteilles d’eau | 14.00 | Menues dépenses | 100.00 | |
| Combustible pour le chauffage | 700.00 | |||
| Direction | 1 000.00 | |||
| Total de la recette | 3 498.00 | Total de la Dépense | 2 700.75 | |
| Reste net | 792.75 | |||
| Tarif de l’établissement | ||||
| Bain, | durée 1h | 1.00 fr | ||
| Douche | Durée de 15 à 20 minutes | 1.00 fr | ||
| Buvette | Pour toute la saison | 2.00 fr | ||
| Eau | Le litre | 0.50 fr | ||
Des Eaux Minérales de Montbrun (Drôme)
et de leur Action au point de vue
Physiologique et Pathologique
-_ ° _-

En présence des effets puissants que les Eaux de Montbrun produisent sur l’organisme, des critiques de bonne foi leur ont souvent adressé le reproche d’être trop fortes. Comment, disent-ils, ne pas s’effrayer des perturbations qu’elles apportent dans la vitalité de nos organes ; comment concilier un état d’éréthisme constant et général avec les conditions physiologiques nécessaires au fonctionnement régulier de toutes nos parties ?
Nous ne chercherons point à nier cette force ; oui, les Eaux de Montbrun ont une force d’action qui n’a point d’analogue dans nos latitudes, mais le fer, l’iode, le mercure et le quinquina ont une force aussi à nulle autre pareille, et il n’est venu à l’esprit de personne d’en faire une cause de proscription. La force, c’est la vie : que peut-on attendre d’une force négative, de l’inertie enfin !
Est-ce à dire que ces Eaux soient d’une innocuité parfaite et que tous les malades puissent indistinctement venir y chercher la santé ? Assurément non, et cette même force du principe sulfureux qui opère des prodiges, doit être dirigée avec prudence pour qu’elle ne s’égare pas ou qu’elle ne dépasse le but qu’on se propose.
Si la physiologie était une vérité ; si les sources de la vie nous étaient manifestées et que Dieu nous livrât le secret de la nature, il nous serait facile de déterminer d’une manière rigoureuse les modifications et les conditions nouvelles que les Eaux sulfureuses apportent dans nos organes, mais ce quid divinum sera longtemps encore l’objet de nos recherches et de nos méditations, et l’expérience seule guidera nos pas. Toutefois, si nous considérons l’action que les Eaux de Montbrun exercent sur l’organisme, nous arriverons par induction et avec le secours des idées généralement admises, à des applications pathologiques que justifie l’expérience de chaque jour. Quelle est cette action ?
A l’intérieur, les Eaux de Montbrun agissent et s’administrent :
- Comme altérantes ;
- Comme sudo-diuriétiques ;
- Comme purgatives.
Comme altérantes, on les prend de une à cinq verrées dans les 24 heures, et ce mode d’administration, qu’on pourrait appeler homéopathique, produit des effets lents dans leurs manifestations, mais qui réagissent sur tous les systèmes et se traduisent par une modification dans les fonctions générales. Le traitement des diathèses rentre dans cette catégorie.
Comme sudorifiques et diurétiques elle s’administrent à la dose de cinq à dix verrées. Ce mode d’emploi produit constamment une excitation de l’appareil digestif, des organes cutané et génito-urinaire. L’appétit se fait vivement sentir, les urines plus abondantes déposent de sédiments variés, et la peau, dont les pores sont largement ouverts, présente un aspect huileux et répand une odeur pétrolique. En même temps toutes les muqueuses participent de l’éréthisme général. Dans cette catégorie rentrent les dépurations, les modifications, les diathèses psorique et rhumatismale.
Comme purgative, la dose est de dix verrées et au-dessus prises à peu d’intervalle. C’est le traitement des embarras gastriques et intestinaux, des dérivations et des obstructions.
Mais si les Eaux de Montbrun prises à l’intérieur exercent une influence appréciable sur l’organisme, les bains produisent des effets bien autrement sensibles. La première impression qu’on éprouve en se plongeant dans un bain tiède, consiste dans le sentiment d’oppression et de resserrement. Bientôt la peau rougit légèrement et laisse percevoir un picotement incommode. Alors la poitrine se dilate, l’inspiration se prolonge en même temps que la circulation augmente de force et de vitesse. Un bien-être inconnu s’empare du baigneur qui, en sortant de l’eau, semble déchargé d’un pesant fardeau. Tous ces symptômes se dissipent peu à peu ; la peau cependant reste onctueuse et sudorale, et l’éréthisme s’établit.

En s’arrêtant un instant sur l’action physiologique que nous venons de décrire, on comprendra tout le parti que la médecine peut se promettre de pareils effets, et les applications pathologiques en deviendront plus faciles. Mais nous ne devons pas perdre de vue que si la spécialité des Eaux de Montbrun se traduit directement dans l’herpétisme et le rhumatisme, l’action secondaire embrasse à peu près le cadre nosologique des affections chroniques. Quand la médecine hippocratique aura déblayé entièrement le terrain de l’école organicienne et que les pyrrhoniens ouvriront enfin les yeux à la lumière, peut-être serons-nous mieux compris en parlant de dépuration et de diathèse. En attendant nous laisserons nos lecteurs sous l’impression de la parole de M. Marchal (de Calvi) :
« ... Mais de toutes les diathèses, la plus commune, la plus générale, est la diathèse herpétique ; c’est plus crûment la diathèse dartreuse, si générale en effet, que je ne connais presque pas de famille qui en soit complètement exempte ; seulement les signes ou manifestations de cette diathèse sont très divers, très insidieux. Quand la manifestation herpétique a lieu à la peau, rien de plus simple ; mais quand elle se produit dans l’estomac, sous forme de gastralgie ou de dyspepsie, dans l’intestin où elle cause des troubles divers de la digestion ; dans la gorge où elle donne lieu à une angine très commune ; dans le larynx où elle produit le catarrhe avec enrouement ; dans la vessie et la matrice qui deviennent le siège de sécrétions anormales, etc. , dans tous ces cas on a de la peine à reconnaître l’influence de la cause générale ou diathésique. Un homme pourtant a mesuré le domaine immense de la diathèse herpétique à laquelle il a donné le nom de psore ; cet homme qui a eu là une vue de génie, c’est Hahnemann. »
H. Bernard
Montbrun, le 10 mai 1862
-_ ° _-
Les curistes et leurs affections
Les Archives Départementales de la Drôme ne disposent que d’un seul rapport d’activité complet, celui de l’année 1868. Pour les années suivantes, il ne reste que les bilans comptables. C’est peu et beaucoup à la fois.
Les thermes ont officiellement commencé 3 ans avant, en 1865. La période de « rodage » est achevée. Il n’y a pas encore eu le désastre de 1870 et le déclin qui s’ensuivit.
1868 est donc une bonne année d’observation.
Pour les 84 curistes ayant fréquenté les thermes en 1868, le rapport décrit en 50 pages manuscrites détaillées, les nom, prénom, âge, origine, profession, affection, durée, traitement déjà suivi, traitement aux Thermes, résultats en fin de cure et résultat durant l’année. Il y a même deux colonnes supplémentaires titrées « tempérament » : simple, nerveux, sanguin, lymphatique ; et « constitution » : faible, bonne, forte, herpétique. Derniers vestiges de la théorie des humeurs…
Avant de décrire les affections qui ont motivé la cure, je vais relever l’origine géographique et sociale des curistes.
Origine géographique et sociale des curistes en 1868
Parmi les 85 curistes, 60 sont originaires du Vaucluse, 7 de la Drôme et autant des Bouches-du-Rhône. Ils viennent ensuite des Alpes-de-Haute-Provence (4), des Hautes-Alpes (2), du Var (2), du Gard (1) et de la Haute-Garonne (1).
On remarque immédiatement la prévalence du Vaucluse qui représente à lui seul 71% du total, la Drôme atteignant difficilement 7%. Il faut bien reconnaître que Montbrun est plus éloigné de la ligne de Chemin de Fer PLM que du Vaucluse dont elle est frontalière.
15 Vauclusiens viennent d’Apt (45 km), 8 d’Avignon (80 km), 4 de Vaison-la-Romaine (40), 2 d’Orange (65 km), 2 de Cavaillon (62 km), 2 de Bonnieux (55 km), puis 1 pour chacune des villes de Vedène, Valréas, St Saturnin-lès-Avignon, St Saturnin-lès-Apt, St Marcellin-lès-Vaison, Fontaine-de-Vaucluse, Saumane, Sault, Roaix, Pertuis, Pernes-les-Fontaines, Mormoiron, Mondragon, Ménerbes, Mazan, Malaucène, L’isle-sur-la-Sorgue, Lauris, Gordes, Cadenet, Buisson, Ansouis.
On voit bien que les vauclusiens n’hésitent pas à franchir le Ventoux pour prendre les Eaux à Montbrun.
Parmi les 7 drômois, 2 viennent de Suze-la-Rousse en famille (65 km), 2 de Bouchet (67), et 1 pour chacune des villes de Montélimar (100 km), Marsanne (110 km) et Livron (130 km).
On ne compte que 2 haut-alpins de Ribiers (63 km) et 4 bas-alpins de Curel (29 km), Simiane (31 km), Sisteron (54 km) et Mison (56 km).
Enfin 6 marseillais (135 km) et 1 de Noves (73 km), 1 de Toulon (185 km) et un du lointain Toulouse (410 km).
Ce qui démontre si besoin en était encore que la zone d’attraction du canton de Séderon est plus méridionale que dauphinoise.
Parmi les professions, on compte cette année-là :
1 agent d’assurance, 1 avocat, 1 boulanger, 1 buraliste, 1 chaudronnier, Chef de bureau à la préfecture d’Avignon, 1 commerçant en tissus, 1 comptable au commis agricole, 1 Conducteur des Ponts et Chaussées, 1 confiseur, 1 cordonnier, 2 courtiers, 8 cultivateurs et 1 cultivatrice, le directeur des Casino de Toulon, 1 médecin, 1 employée des Postes, 1 épicier, 1 fabricant de papier, 1 horloger, 1 horticulteur, 1 inspecteur des contributions, 1 instituteur, 1 lingère, 1 maçon, 2 tailleurs, 1 marchande, 1 ménagère, 2 meuniers, 1 prêtre, 1 professeur au lycée de Toulouse, 13 propriétaires, 4 rentières, 1 représentant de commerce, 1 restauratrice, 19 sans profession, 1 serrurier, 1 sous-secrétaire des messageries, 1 tonnelier.
Large éventail où l’on voit que les curistes les plus éloignés, de Toulon et Toulouse, font partie des classes élevées.
Les affections et leur guérison
La terminologie médicale de l’époque utilise fréquemment les termes désuet de diathèse et de scrofule qui méritent une explication.
- un ensemble de signes cliniques et de symptômes qu’un patient est susceptible de présenter successivement ou simultanément, et supposés avoir une origine commune. Dans ce sens, on emploie plutôt aujourd’hui le terme de syndrome.
- une tendance d’un organisme à répondre de façon pathologique à certaines stimulations. On parle plus couramment de prédisposition ou de susceptibilité.
Scrofuleux : Toute infection chronique banale de la peau et des muqueuses (otites, rhinites, etc.) ou inflammation des ganglions et des articulations (d’apr. Méd. Biol. t. 3 1972).
Rem. La plupart des formes de scrofule sont actuellement classées parmi les affections tuberculeuses ou syphilitiques : La forme de tuberculose qui en résulte ressemble singulièrement, dans sa première phase, à celle qui caractérise chez l’homme, surtout dans l’enfance, la scrofule (Calmette, Infection bacill. et tubercul., 1920, p. 122).
Ce qui nous permet de mieux comprendre le tableau récapitulatif suivant.
| Nom des maladies | Nbr de chq espèce de maladie | nbr de malades guéris | Nbr de malades soulagés | Nbr de malades sans changement | Nbr d’aggravations | Nbr de soulagement postérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diathèse
herpétique |
42 | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 |
| Diathèse
rhumatismale |
25 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Diathèse
scrofuleuse |
23 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Diathèse
syphilitique |
10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Affection
mixtes |
15 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Totaux | 115 | 60 | 29 | 5 | 8 | 13 |
Le nombre de maladies recensées supérieur à celui des curistes s’explique par le fait que certains patients viennent pour soigner plusieurs pathologies.
Pour le reste le secret médical m’interdit d’en dire beaucoup plus. Des rhumatismes, la tuberculose, des maladies de peau, des maladies nerveuses.
De façon anecdotique, plusieurs hommes viennent pour soigner un eczéma des bourses, des patientes pour des métrites et descentes d’organe.

1e page du registre
L’Arrêté Ministériel du 15 septembre 1933 suspend l’autorisation d’exploitation pour les deux sources « Rochers »et « Plâtrières », celles-ci étant restées inexploitées plus de 5 ans.
En 1941, la société Casino achète l’ancien établissement thermal et ses deux sources pour le transformer en « établissement social » et centre de vacances pour ses employés. Les installations thermales tombent rapidement en ruines, mais la mairie conserve le droit d’usage des deux sources minérales à des fins thérapeutiques, avant que la société Casino ne les lui cède.
La construction du nouvel établissement, à quelques centaines de mètres de l’ancien, démarre fin 1986, et il sera inauguré le 4 mai 1987.

Les thermes de Montbrun sont actuellement agréés pour 2 secteurs médicaux : affections des voies respiratoires et rhumatologie. La fréquentation de l’établissement thermal se stabilise aux alentours de 400 curistes par an (données 2004).
Une première extension en 2007 est destinée à accueillir 1500 curistes. La fréquentation croissante amène à envisager une seconde extension permettant des soins à 2500 curistes et le développement de l’activité « en forme » dans un bâtiment dédié.
Mais se pose la question de la ressource en eau. Tel est le débat qui oppose les différentes parties prenantes : municipalité, exploitant Valvital, association « vivre à Montbrun ».
Je ne résiste pas à la tentation de vous montrer la nouvelle salle d’inhalation.

Sources :
- Dossier provisoirement coté 05 M 185 des Archives Départementales de la Drôme
- (Extraits de Ressource en eau thermale de la station de Montbrun-les-Bains. Rapport final. BRGM/RP-53084-FR Décembre 2004. pp. 36-38)
- Le comportement politique dans les Baronnies Drômoises de 1864 à 1914.
Maurice Gontard. Publications de l’Essaillon. Séderon, 2007 - Tableau généalogique de la famille Harouard de Suarez d’Aulan : jean.gallian.free.fr
- Etudes Drômoises. N° 42. Juin 2010.
- Wikipedia
- Ventoux Magazine, n° 36 Printemps 2018