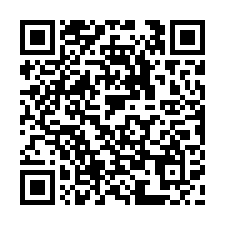Le Trésor de Séderon
– Durant l’été, « notre Trésor » a été remis en lumière : la Commune a organisé une conférence de M. Dhénin, dans l’église de Séderon. Comme elle voulait l’accompagner par une exposition à l’Office du Tourisme, l’Essaillon lui a apporté toute son aide : nous avons mis à disposition nos textes et nos photos publiés dans les bulletins depuis la découverte. Et même nos panneaux d’affichage.

Le fait générateur de ces manifestations remonte à 2014, lorsque le Musée départemental des Hautes-Alpes à Gap avait consacré une exposition à ses collections numismatiques, collections dont le Trésor de Séderon fait partie.
Il faut signaler le catalogue paru pour l’occasion et titré « Conter la monnaie » (c’est à la mode, ce genre de titre-formule qui utilise le son des mots pour jouer sur leur sens). Il réserve une place importante au Trésor de Séderon, des pages 76 à 97.
Clés de voûte
– Le même motif, sculpté sur quatre pierres clés de voûte de portes dans nos villages, cela vaut un petit paragraphe.

© Essaillon
|

© Essaillon
|

© Essaillon
|

© Essaillon
|
A partir d’un axe vertical, le motif est symétrique. En allant du bas vers le haut, on trouve un demi-cercle (ou demi-ovale), puis des losanges. Dans un cas, il y a 1 demi-ovale et 3 losanges ; dans un autre, 3 demi-cercles concentriques et 3 losanges ; dans le 3e cas la pierre est très érodée, j’y vois 1 demi-cercle et 4 losanges ; dans le 4e cas, la pierre étant encore plus érodée, on devine le demi-cercle – pour les losanges, il faut les yeux de la foi.
Cela fait penser à une plante, genre fleur à bulbe, voire un arbre schématisé. S’agit-il d’un symbole ? d’un motif distinctif dont un tailleur/sculpteur de pierre aurait fait sa spécialité ? Sur l’une des pierres, on peut lire une date : 1682.
Sur cette photo, récupérée sur un site internet, le dessin est plus moderne ; mais je crois voir des similitudes

© Essaillon
|

© Essaillon
|
« Les Baronnies vues du col du Négron »
– c’est la couverture de notre Trepoun : Derrière l’arbre (celui de gauche, déjà plongé dans l’ombre par la haute crête de Lure) est niché Séderon. On ne voit pas le village, mais il y a la Tour ! Et la lumière, c’est vraiment la nôtre, celle de l’automne en Baronnies. La photo est signée d’un artiste, dont je vous ai déjà parlé dans un siècle de cartes postales à Séderon (Trepoun n°49 – 2010), Pierre Ricou.
Ricou fut l’un des premiers photographes à créer des collections d’images, dès les années 1970. Le noir et blanc des débuts fut remplacé vers 1980 par la couleur qui permettait un choix de lumières et de teintes violentes. Tout ça édité en cartes postales.
Ricou a ainsi composé une fresque de lieux et de scènes pour lesquels il avait choisi le titre de Provence à découvrir. Dans notre région, ce sont la foire aux agnelles de St Vincent sur Jabron, le marché au tilleul de Villefranche qui attirèrent son œil et son objectif. Il y eut aussi plusieurs cartes sur Séderon. Il nous a permis de reproduire gracieusement cette photo, qu’il en soit remercié.
Brillant illustrateur, Ricou a participé aux côtés de Pierre Magnan à la réalisation du très bel ouvrage La Provence de mes romans (Denoël – 1996). On retrouve la signature des deux artistes sur la quatrième de notre couverture.
Remède pour bête méchante
(on suppose qu’il s’agit d’un cheval, ou autre équidé) :
1 demi once d’opiom en morceaux
Du Pagau ou tête de pavon
1 litre de vin
Faire bouillir le soir à petit feu et le donner le matin à la bête à jeun.
Faire boire par le nez.
Après, uriner dans la bouteille et le faire boire.
Ensuite faire tourner la bête vite et ensuite faire faire 2 kilomètres à la bête.
Faire boire par le nez.
Henri Roux était forgeron quartier de l’Essaillon. Ce remède est extrait de son cahier de comptes (voir l’article « Caïffa » d’Hélène Andriant).
Suzanne Jouve nous écrit
pour nous donner des précisions à propos de M. Meffre, celui du précédent Trepoun, dans l’article consacré à l’abbé Isidore Bertrand « que vous n’avez pas réussi à identifier. Je pense qu’il s’agit de Célestin Meffre, cousin germain de mon beau-frère René Pascal. Il est né à Izon, son père Maxime Meffre avait épousé la sœur du père de mon beau-frère, Aimé Pascal. Il est parti au Maroc où il a construit une usine de volets roulants et de menuiserie qui a très bien marché. D’ailleurs mon beau-frère René Pascal l’a rejoint en 1949.
Célestin Meffre s’est marié, a eu des enfants dont la dernière fille Marthe, vivant à Casablanca, est décédée l’an dernier et a été enterrée à Marseille dans le caveau familial.
Il existe toujours à Eygalayes la maison de Nida. Elle borde le Riançon, le petit ruisseau à l’est d’Eygalayes. »
Les barretiers des bataillons de volontaires,
morts pour la République après 1789 Lorsque, à la fin de l’année 1790, se manifesta l’hostilité des vieilles monarchies européennes contre la Révolution, l’armée française se trouvait très affaiblie par l’émigration des principaux chefs et par l’indiscipline des soldats.
Les troupes françaises de toutes armes, autres que les gardes nationales, devaient être recrutées par engagements volontaires et à prix d’argent, comme autrefois, mais avec contrats passés devant les municipalités. Plusieurs levées sont décidées en quelques mois, qui produisent les 170 premiers bataillons de volontaires nationaux. Leur nombre est porté successivement à 200, 380, 502 et 755 bataillons. L’armée était alors composée des régiments d’Ancien Régime et des bataillons de volontaires nationaux.
Composition des bataillons de volontaires : les volontaires devaient former des bataillons de 8 à 10 compagnies de 50 hommes commandés par 3 officiers. Chaque bataillon est composé de 8 ou 9 compagnies d’infanterie et d’une compagnie de grenadiers. L’effectif de ces bataillons a varié de 500 à 800 hommes. Le bataillon était commandé par 1 colonel et 2 lieutenants – colonels, tous élus par les volontaires.
Chaque garde national recevait une solde de 15 sous par jour ; le caporal et le tambour, une solde et demie ; le fourrier et le sergent, 2 soldes ; le sous-lieutenant 3 soldes ; le lieutenant 4 soldes ; le capitaine 5 soldes ; le lieutenant-colonel 6 soldes et le colonel 7 soldes. Comme on peut le penser, ces soldes étaient un attrait indéniable pour des jeunes gens peu fortunés et à la recherche d’emploi.
L’amalgame des armées – les demi-brigades : début 1793, la situation des armées de la République est chaotique. Les unités de la ci-devant armée royale ont vu leurs rangs s’éclaircir. Les bataillons de volontaires de 1791, puis 1792, avant ceux de 1793 et 1794 ont attiré la grande majorité des jeunes hommes disponibles par engagement révolutionnaire, mais aussi en raison de la solde plus élevée et d’une discipline moins sévère… Mais là aussi les pertes, les désertions, les épidémies réduisent les effectifs théoriques. On décide donc d’amalgamer armée royale et bataillons de volontaires nationaux (décret de la Convention du 21 février 1793).
Ce décret sur l’amalgame associe deux bataillons de volontaires et un bataillon de ligne de l’ancienne armée royale dite ci-devant pour constituer une unité nouvelle, la demi-brigade. Le décret prévoyait l’amalgame des 198 bataillons de ligne, unis à 396 bataillons de volontaires, pour former 198 demi-brigades d’infanterie de ligne. La force de chaque demi-brigade, prévue par le décret, est de 2 437 hommes, officiers et canonniers compris comprenant 3 bataillons. Toutefois les formations eurent des effectifs très variables.
L’organisation de l’armée fut définitivement effectuée à partir du 9 pluviôse an II (28 janvier 1794). Les registres d’état-civil de Barret de Lioure mentionnent les noms des enfants de la commune décédés dans ces bataillons de volontaires, sans autre indication. Il s’agit de :
- Félix HILLY, né le 23 novembre 1771, fils de Joseph et Marguerite Chabaud, volontaire de la 1e réquisition du bataillon de Nyons, décédé le 17 fructidor an II.
- Joseph Jérôme JEAN, né le 12 décembre 1770, fils d’Alexis Jean et Suzanne Bonnefoy, volontaire de la 1e réquisition du Bataillon de Nyons, décédé le 6 vendémiaire an III.
- Laurens PASCAL, né le 28 août 1769, fils de Mathieu et de Marie Anne Espieu, volontaire de la 1e réquisition du Bataillon de Nyons, décédé le 15 brumaire an III.
- Jean Gabriel ARNAUD, le 5 mars 1770, fils de François et de Marie Anne Bladier, volontaire dans le bataillon de la Drôme, en congé, décédé le 11 nivôse an III (probablement membre de l’ancienne armée royale).
- Mathieu BOREL, né le 6 janvier 1762, fils de Mathieu et de Marianne Ravy, muletier au service de la République dans l’armée d’Italie, décédé le 2 brumaire an III.
[Gilbert PICRON]
Paule Delsart
n’apportera plus sa contribution dans les colonnes du Trepoun. Elle est décédée à 85 ans, le 31 octobre 2015 à Rochefort, en Charente maritime, où elle et sa famille s’étaient fixées depuis une quarantaine d’années, après le long périple que sa vie professionnelle d’institutrice et celle de son mari, militaire, leur avaient imposé : plusieurs villages des Hautes Alpes où elle avait commencé sa carrière, le Maroc, Nîmes, l’Allemagne, et enfin Rochefort.
Elle avait vécu son enfance et sa jeunesse à Séderon et y était restée très attachée malgré l’éloignement. Elle aimait raconter ses souvenirs du pays de son enfance et des gens qu’elle y avait côtoyés. Une voix s’est éteinte, mais qui restera dans le cœur de ceux qui l’ont connue.