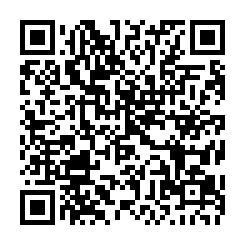A l’automne 1997, les médias, notamment la télévision et divers magazines, ont largement présenté différents aspects d’Halloween, cette fête anglo-saxonne, plutôt carnavalesque, qui se manifeste, dans certains pays par la décoration, la sculpture de citrouilles à des fins ludiques, la veille de Toussaint. Cette évocation a fait revivre dans ma mémoire des jeux qui se pratiquaient à SEDERON au temps de mon enfance.
A cette époque, citrouilles et courges (les « coucourdes ») étaient produites en abondance dans les champs et les jardins potagers pour les besoins alimentaires tant des animaux que des familles. Les variétés allaient de l’énorme potiron pouvant peser plusieurs dizaines de kilos à des fruits plus raffinés et de moindre taille, sans oublier les courgettes et les fameuses pastèques à peau marbrée (les « gigerines ») dont les morceaux devenus transparents dans la confiture étaient si délicieux sous la dent. A vrai dire, la courge dont le nom fut souvent employé de manière péjorative à l’égard de personnes sottes ou naïves (« sies uno coucourdo » = tu es bête) n’a pas une réputation très valorisante sur le plan nutritionnel. En témoigne ce dicton du pays : « Il faut autant de courge pour nourrir un homme que de neige pour chauffer un four ». Et cependant !...
Notre voisin Louis Cotton récoltait toutes sortes de ces cucurbitacées, orangées, jaunes, vertes, à écorce brodée... Il destinait les plus volumineuses et les plus banales à la nourriture des animaux qu’il élevait avec art, des porcs notamment. D’autres étaient choisies pour les usages culinaires. Marie Cotton, son épouse, un vrai cordon bleu, excellait dans la préparation du gratin de courge, cuit dans le plat de poterie vernissée (le très populaire « tian »), et de celle de la glorieuse tarte à la compote de courge qui se dégustait dans de nombreux foyers aux alentours de Noël. Le rapport avec Holloween ? me direz-vous ? – Nous y voici. Mais il fallait bien éclairer – c’est le cas de le dire – le contexte.
Mon camarade et voisin Paul Reynaud (frère de Guy) neveu des Cotton, pouvait disposer de ceux de ces fruits qui lui étaient abandonnés en raison de leur petite taille. Chaque année donc, vers la mi-octobre, nous jouions avec ces petits potirons. Le jeu consistait à découper au couteau une calotte à la partie supérieure du « coucourdon », à en évider l’intérieur en le débarrassant de la pulpe, à dessiner et à sculpter ensuite dans l’écorce des trous en forme d’yeux, de nez, de bouche, bref à produire une sorte de crâne humain. La nuit venue, nous placions à l’intérieur une bougie allumée et remettions en place la calotte. Cette tête, avec ses orbites et autres ouvertures éclairées de lueurs jaunâtres et vacillantes prenait dans les ténèbres un aspect fantasmagorique saisissant.
Paul, farceur en diable, eut un jour l’idée qui me parut géniale, de faire une farce à la fille du receveur des postes (le prédécesseur de M Gondre). A cette époque le bureau des P.T.T. se trouvait au rez-de-chaussée de l’actuelle maison Espieu-Boyer. L’ancien lavoir public, avec son goulot de laiton ouvragé, tourné vers la route, laissant couler généreusement l’eau claire du haut de sa borne de pierre était parallèle à cet immeuble. Le toit supporté par une charpente de bois reposant sur quatre piliers de fonte abritait les bassins.
l’ancienne poste, actuellement nougat boyer
Un soir, après la tombée de la nuit, Paul et moi avons fébrilement, mais avec soin, préparé un potiron en forme de crâne illuminé et sommes allés le hisser à quelques mètres de hauteur sur le fronton qui soutenait les poutres du toit… Après avoir ainsi œuvré en silence, puis contemplé pendant quelques instants notre ouvrage avec satisfaction, nous avons frappé à la porte du receveur en appelant la fillette (que nous connaissions bien). Cette dernière se précipite hors de la maison pour chercher, des yeux, dans la pénombre, les amis qui l’invitaient, sans se douter que nous étions cachés. Elle s’aventure jusqu’au bout du trottoir, intriguée... Soudain, elle aperçut, dans sa lumière jaune, cette espèce de face fantasmatique, étrangement clignotante, au dessus de la fontaine... Elle se rua chez elle, poussant les hauts cris. Alerté, le reste de la famille sortit aussitôt et ne put que constater le phénomène, sans le comprendre tout à fait, mais se doutant qu’il y avait là quelque farce. Blottis contre le lavoir, nous riions sous cape et n’avons eu garde de nous montrer... Puis, satisfaits, nous avons abandonné là l’objet insolite qui acheva, dans la solitude de la nuit, son triomphe éphémère.
On peut se demander quand et comment l’idée de cette pratique, voisine de celle de Halloween a pu parvenir à Séderon. Etait-elle le prolongement d’une tradition locale ? A-t-elle été importée ? Pourrait-elle revivre de nos jours ? Encore faudrait-il que la culture des cucurbitacées continue autour du village. De toute façon il est réjouissant de constater que le passé de notre bourg est plus riche qu’on ne le pense généralement. Resterait peut-être à l’explorer avec constance et, éventuellement, à le perpétuer dans les conditions de notre temps.
P.S. Un reportage télévisé sur Halloween a présenté, aux environs de la Toussaint 97 la production de courges sculptées et éclairées tout à fait semblable à celle que j’ai pratiquée jadis.
D’autre part une émission de FR3 la veille de ce Noël 97 a montré la fête des « guenels » dans un bourg du nord de la France. Il s’agissait d’un défilé folklorique très animé dans lequel les participants portaient d’étranges « crânes » illuminés fabriqués de façon analogue avec non pas des courges, mais des betteraves évidées et sculptées appelées « guenels ». Ces traditions ont vraisemblablement des origines très anciennes. La parole est aux anthropologues...