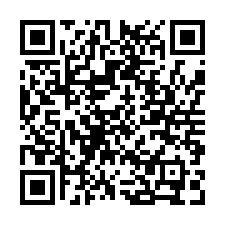A une époque déjà lointaine qui se situe dans le premier tiers du 20ème siècle, la scolarisation des enfants ne commençait qu’à l’âge de 6 ans. A Séderon elle débutait en fait dès 5 ans grâce à une section enfantine mixte créée à la demande du conseil municipal et prise en charge par Madame JOURDAN jusqu’à l’arrivée de Madame DELHOMME en 1937.
En deçà de cet âge, les mères de famille — quelquefois assistées par les grand’mères — devaient concilier leurs activités professionnelle et ménagère avec la garde des jeunes enfants, aujourd’hui en classe maternelle 2 à 3 ans plus tôt. Comme en ce temps-là, les familles pouvant s’assurer les services d’une nurse étaient rares, à l’instar des enfants de ma génération je ne m’éloignais guère des jupes de ma mère, ce d’ailleurs dont je m’accommodais fort bien.
C’est ainsi qu’avec quelques amies elles s’accordaient un peu de détente l’après midi ; à la belle saison cette récréation se tenait à proximité de la maison paternelle, sous les frais ombrages des acacias et d’un noyer séculaire aujourd’hui disparu ; jouant à leurs pieds j’écoutais sans les entendre les propos qu’elles tenaient. Lorsque les échanges prenaient un ton plus libertin ma mère - selon ses dires - l’index posé verticalement sur ses lèvres tentait d’alerter ses amies de ma présence ce à quoi elles répondaient en riant :
« Peuchère, le pôvre, il est trop petit pour comprendre ».
Un jour cependant alors que l’une d’elles racontait une histoire que les autres écoutaient, bouche bée, suspendues à ses lèvres, je m’étais parait-il arrêté de jouer fixant intensément la narratrice ; était-ce le sujet évoqué par le récit ou l’attitude de l’auditoire obnubilé par son contenu ? J’étais toujours trop petit pour comprendre, mais quelque chose venait de s’inscrire de façon indélébile dans mon subconscient.
Aussi, quelques années plus tard, alors que j’avais suffisamment grandi pour comprendre, je rappelais à ma mère ces faits, qu’elle avait toujours en mémoire. Après quelques instants de réflexion, elle me rapporta l’aventure survenue à une lointaine aïeule de cette amie dont le récit avait tant troublé le garçonnet de moins de 5 ans que j’étais alors.
Il s’agissait d’une conversation entre jeunes femmes sur un sujet toujours d’actualité de nos jours et débattu sans cesse depuis la nuit des temps :
- La peur et le courage.
Si la plupart d’entre elles considéraient que nul ne peut ignorer la peur, la dernière prétendait n’avoir jamais éprouvé un tel sentiment, se gaussant bruyamment de la poltronnerie de ses camarades. Piquées au vif celles-ci décident alors de lui imposer une épreuve pour savoir si son soi-disant courage n’était pas une simple fanfaronnade. Il est convenu que l’épreuve consisterait à planter un pieu de bois à minuit, au milieu du cimetière...
Le soir même quelques instants avant minuit, la téméraire jeune femme munie d’un pieu et d’un maillet de bois pénètre dans le cimetière - observée à distance très respectueuse par ses amies. Pour celles-ci toutes tremblantes, un effroyable suspense commence, dans le silence de la nuit elles entendent nettement les coups de maillet sur le pieu que l’on enfonce dans le sol, puis, à part leurs propres claquements de dents qu’elles ne peuvent réprimer sous l’empire de la peur, nul bruit ne vient troubler le calme nocturne.
Il y a longtemps que la jeune femme devrait être de retour, mais elle ne parait toujours pas pour ses amies. L’angoisse est insupportable, la peur se transforme en panique, elles courent alors donner l’alerte.
Équipés de lanternes une demi-douzaine d’hommes - partagés entre le sentiment d’une mauvaise plaisanterie et une peur confuse qu’il est difficile d’avouer - pénètre dans le cimetière trouve la jeune femme allongée à l’endroit convenu prononçant des mots dont le sens peut être ainsi traduit :
- Ils me tiennent par mes vêtements.
Beaucoup plus simplement il est apparu que, dans l’obscurité, elle ne s’était pas rendue compte qu’elle plantait le pieu dans le tissu de sa longue robe, ce qui bien sûr l’empêchait de se redresser.
L’héroïne fut parait-il marquée à vie par cette mésaventure ; si elle n’a pas réussi à prouver que la peur lui était étrangère, au moins a t-elle manifesté un réel courage. Le débat reste donc ouvert.
Il ressort de cette aventure pour le moins étrange - en supposant ces faits avérés - que les cimetières en général et le nôtre en particulier ne sont pas des milieux hostiles, pleins de sortilèges et autres maléfices colportés par la croyance populaire ; bien au contraire ils sont souvent plaisants et agréables.
Les Pieds Noirs ne disaient-ils pas :
« Tellement il est beau le cimetière de Bône.Envie de mourir il te donne »,
qui sait ce qu’il est advenu aujourd’hui du cimetière de Bône, devenu Annaba ?
Plus près de nous le cimetière de Forcalquier est une véritable oeuvre d’art et l’on vient de loin pour le visiter.
Nous avons tous un attachement particulier pour le cimetière National d’Eygalayes lorsque l’on se remémore les atroces conditions dans lesquelles furent exécutées les victimes du maquis d’Yson.
Il y a quelques années, j’ai pu visiter les lieux historiques des plages Normandes où le 6 juin 1944 débarquèrent les troupes alliées. Si les vestiges de cette gigantesque opération militaire demeurent visibles ce sont surtout les cimetières militaires qui m’ont fait la plus forte impression. Les âpres combats de cette mémorable journée et de la campagne de Normandie coûtèrent la vie à des dizaines de milliers d’hommes dans les deux camps.
Réunis par nationalités dans des cimetières bénéficiant de l’exterritorialité ces lieux sont devenus des havres de paix et de recueillement, objet de tous les soins.
Dans d’immenses terrains gazonnés, les tombes Américaines, par exemple, implantées dans un alignement parfait quel que soit l’angle sous lequel on les regarde, sont surmontées suivant le cas de la croix des chrétiens, de l’étoile de David ou du croissant islamique.
Sur chacune d’elles une sobre inscription indique :
- Le nom et le prénom
- La date de naissance,
- Le Grade,
- Une date, toujours la même : Juin 1944
Devant un tel panorama le visiteur se sent tout petit. I1 imagine le fracas des combats tout en songeant à ces milliers de jeunes vies brisées prématurément et à toutes les potentialités qu’elles portaient, anéanties sans avoir pu s’exprimer.
Je n’ai pas eu l’occasion de visiter les champs de bataille de la Grande Guerre dans le Nord et l’Est de la France, mais il y a tout lieu de croire que leur effet sur le visiteur est identique.
Les cimetières parisiens ont aussi leurs charmes.
Le Père Lachaise avec toutes les célébrités passées et contemporaines qui y reposent et ses gisants parfois extravagants que l’on vient voir du monde entier.
Le cimetière du Montparnasse, observé du 44éme étage de la tour du même nom où je me rendais pour des raisons professionnelles.
Au fil des temps, ils sont aussi devenus des jardins publics, des lieux de promenade - encore protégés de la vie trépidante des rues avoisinantes - où l’on peut voir des enfants jouant en toute quiétude le long des allées bordées de tombes.
D’aucuns pourront penser que cette attirance pour les cimetières résulte d’obsessions macabres ; il n’en est rien bien sûr et l’explication se situe plutôt dans le fait que je me suis familiarisé avec la mort, dès mon plus jeune âge, alors que, enfant de choeur j’accompagnais le prêtre qui venait officier, avant la mise en bière d’un défunt. Cette pratique plusieurs fois renouvelée m’a permis de comprendre - dès l’enfance - que naître vivre et mourir étaient des choses naturelles, même si la dernière étape intervenait parfois de manière prématurée ou brutale. De même, adolescent, la terrible vision des victimes du maquis d’Yson près d’Eygalayes, m’a profondément marqué, tout comme les nombreux autres témoins oculaires.
Aujourd’hui notre cimetière communal fort bien entretenu tant par les soins des services municipaux que celui des familles est devenu un lieu très agréable ; pour la Toussaint c’est un véritable régal pour les yeux ; tombes nettoyées et fleuries, cette date permet d’honorer la mémoire de nos disparus, même si quelques sépultures demeurent oubliées, par défaut de descendance ou ce qui est plus grave par négligence ou indifférence...
Ce jour-là les nombreux visiteurs s’affairent et s’interpellent, le cimetière devient alors le lieu de rencontre annuel avec des parents, des amis, des connaissances heureux de se retrouver et d’accomplir leur devoir de mémoire.
J’apprécie cette effervescence et l’agitation qu’elle induit, mais je préfère un jour plus calme pour réaliser ma visite annuelle ; ce jour-là, libre de toute contrainte je m’arrête longuement devant chaque sépulture évoquant mentalement ceux qui y dorment de leur dernier sommeil, ce qu’ils furent, ce qu’ils réalisèrent durant une vie plus ou moins longue, leur aménité ou leur irascibilité, leurs rapports avec ma famille et avec les autres membres de la communauté villageoise ; si par hasard il m’arrive d’esquisser un sourire, n’y voyez pas une marque d’irrespect, mais plutôt un souvenir agréable ou l’évocation de ces histoires fantasmagoriques, narrées par les anciens où il était question « de loups affamés pénétrant dans les maisons lors des hivers rigoureux » ou « de microbes enchaînés se promenant dans le village »...
Chaque fois je termine cette visite, ressourcé à l’évocation de ces souvenirs d’une enfance insouciante et heureuse et d’une adolescence perturbée par des événements mondiaux qui eurent une répercussion tragique jusque dans notre petit village.
Rasséréné je suis alors en mesure d’affronter à nouveau les aléas d’une société qui pour moderne qu’elle soit n’en reste pas moins dure et implacable. La plupart de ceux qui dorment dans ce lieu de leur dernier sommeil ont laissé ici-bas non seulement une descendance mais aussi des réalisations.
A titre privé ces réalisations - reçues en héritage - sont le fruit d’une vie de dur labeur et parfois de privations. Sur le plan collectif elles représentent tout ce que les générations précédentes ont accompli pour améliorer la vie communautaire : bâtiments communaux et administratifs, lieux de culte, réseaux de distribution d’eau et d’assainissement, réseaux électriques et téléphoniques, routes et chemins etc... Au cours des ans des dizaines d’élus locaux ont apporté à cette oeuvre leur temps leur talent et leur foi.
Cela ne constitue toutefois qu’une infime partie de ce qu’ils laissèrent derrière eux et qui ne figure jamais dans un acte de succession notarié :
Tout d’abord, la vie qu’ils nous donnèrent qui représente déjà une valeur inestimable. A-t-on comptabilisé la somme des nuits de veille, d’angoisse et de tourments assumées, lors de nos maladies contractées en bas âge ? Il faut se souvenir qu’à l’époque de notre première enfance, la mortalité infantile était encore très élevée dans nos campagnes.
Ensuite l’éducation qu’ils nous inculquèrent, travail de patience et de persévérance pour faire entrer dans les chères petites têtes blondes, les vertus morales et civiques fondamentales, le savoir vivre, la vie en société avec ses contraintes, l’instruction générale par la scolarisation souvent poursuivie au-delà du cycle primaire avec ses incidences financières induites.
Enfin la préparation à la vie professionnelle avec un long apprentissage pour ceux qui envisageaient de succéder à leurs parents, agriculteurs, commerçants ou artisans.
De nos jours malgré l’invasion de la cybernétique sous toutes ses formes dans notre vie quotidienne, on parle toujours des secrets culinaires transmis de mère en fille ou de pratique manuelle transmise de père en fils et d’une façon générale, des us et coutumes toujours vivaces.
Tout cela noyé dans l’océan de tendresse, d’amour et de protection dont ils nous ont entourés leur vie durant, représente un patrimoine inestimable.
Au cours de plusieurs décennies de pérégrinations professionnelles, je me suis souvent demandé où pourrait se situer ce qu’il est convenu d’appeler « la dernière demeure » ? C’est finalement le vieux terroir natal qui a emporté la décision. Là, le moment venu je rejoindrai mes grands-parents, mes père et mère et ceux qui me furent chers.
Je pourrai ainsi voir chaque matin poindre le soleil – suivant la saison – sur la barre des Serrières ou la montagne de Palle et le suivre dans sa course jusqu’à ce qu’il disparaisse derrière la montagne de Bergiés, réchauffant ainsi mes vieux os – dans la mesure où ils auront besoin de l’être – pour le restant de l’éternité.
Que souhaiter de mieux, avec à portée de voix et même de main de vieux amis d’enfance, entouré de personnes connues et côtoyées durant de longues années.
Notre vieux cimetière villageois de Saint Charles créé par le maire REYNAUD-LACROZE, au début du 20ème siècle a bien changé depuis la fin de la dernière guerre. Les sépultures sont souvent récentes et bien entretenues et si les vieilles familles Séderonnaises y ont « pignon sur rue », beaucoup de Séderonnais d’adoption ont également souhaité y reposer. Ce sont des populations issues de l’immigration européenne d’avant guerre ou ceux qui à une période difficile pour leur sécurité y ont trouvé un havre de paix et un accueil chaleureux. A coté des croix, l’Etoile de David symbole du judaïsme est maintenant bien implantée.
Si aucune tombe – à ma connaissance – n’arbore encore le croissant Islamique, il est permis de penser qu’un jour ou l’autre, le souhait du patriarche ABRAHAM – père des trois religions monothéistes – de voir se rassembler ses tribus dispersées de par le monde, pourrait se réaliser, tout au moins dans les cimetières…