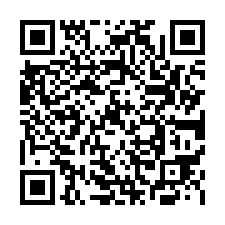Lors d’une promenade estivale à la Mourier avec mon frère l’an dernier, celui-ci me dit avec la même désinvolture que si nous avions discuté du menu du repas suivant : « Tiens, j’ai vu passer dans des ouvrages de botanique une variété très ancienne nommée ‘le blé rouge de Séderon’, et je pense qu’il devait y en avoir ici… ».
Mon frère ayant travaillé plus de 30 ans au Conservatoire Botanique de Porquerolles, aujourd’hui Conservatoire Botanique National Méditerranéen, ayant voué son existence aux variétés anciennes dans le bassin méditerranéen pour créer, entre autres, une banque de semences et des collections variétales pour (je le cite) « maintenir la base génétique la plus large possible en vue de satisfaire les besoins futurs qui ne manqueront pas de se faire jour », je l’ai cru immédiatement.
Mais voilà ! Il est à la retraite, les ouvrages étant propriété de l’INRA (Institut National de Rechercher Agronomique) où trouver cette trace ? Grâce à sa mémoire des noms de botanistes célèbres (!) du passé, grâce à Internet, aux archives en ligne, nous l’avons retrouvé !
Certains recherchent dans leur lignée un ancêtre prestigieux (ce qui ne risque pas de m’arriver, tous de Barret puis de Séderon…), moi j’ai eu la même fierté de voir citer le blé rouge de Séderon que si mon trisaïeul eût été marquis.
La lecture de ces éminents savants, très doctes dans leur matière, a été pour moi – ignare – quelque peu fastidieuse, vous le comprendrez mieux si je vous cite une phrase, pas choisie pour sa complexité, mais parce qu’elle traite d’une population de blé voisine : « Le blé rouge des Omergues nécessite la vernalisation (essais en semi-phytoclimateur, en conditions naturelles estivales avec ou sans éclairement d’appoint nocturne sur coryopses à germination initiée, traités au froid et non traités, avec témoins ad hoc), cependant quelques formes non barbues ou semi-aristées ne nécessitent pas cette vernalisation. » (C. C. Mathon, 1985)
Je vais donc tacher de vous parler du blé rouge de Séderon avec simplicité, et je m’excuse auprès des lecteurs avertis si cette vulgarisation m’entraîne à des erreurs.
Les deux grandes familles de blé ancien dans le Sud-Est sont :
- La Touzelle rouge de la Provence (ou de la Drôme, selon les auteurs) dite aussi « Rouge de Provence » (Vilmorin 1880) qui est une variété ancienne du Sud-Est. « Grain rouge, petit, un [peu] glacé. L’épi est long ; la paille blanche et longue est sujette à la verse. Très sensible à la rouille ; dit à partir de 1915 « Rouge de Provence ».
- La Saissette de la Drôme : blé barbu, utilisé en Provence, semis d’automne.
Dans le Dictionnaire classique d’histoire naturelle, chapitre blé du Sud-Est (t. 7), sont cités :
- La Touzelle rouge : « épi lâche ; épillets barbus, balles rousses et glabres.
- La Saissette de Tarascon.

Après évènements, confusion et méli-mélo d’auteurs anciens, Claude-Charles Mathon – Docteur ès-sciences, Directeur du Service d’écologie et de biogéographie à la Faculté des Sciences de Poitiers, passionné des céréales du Sud-Est (il avait une maison à Redortiers), auteur de 23 publications – dénoue patiemment tous les fils et classe dans les touzelles notre blé rouge de Séderon (« A la recherche du patrimoine : sur quelques blés traditionnels du Sud-Est de la France »). Dans « Publications de la Société Linnéenne de Lyon / Année 1985 », je cite donc :
Le Blé Rouge de Séderon : « population cultivée à Séderon, originaire de La Rochette-du-Buis, à épi barbu, semi-barbu et non barbu, rouge et jaune, à grain roux dominant mêlé de grain plus ou moins jaune avec peu d’avoine mais diverses autres impuretés crucifères notamment. Population voisine – mais différente – du Blé rouge des Omergues ».
Donc notre blé rouge de Séderon est une touzelle.
Dans Lou Tresor dóu Felibrige de Mistral, « Tousello, toueisello (nord-provençal), tusello, tuello (provençal maritime), tueillo (niçois) » Touselle : froment dont l’épi est sans barbe. […] Tousello roujo : froment d’automne à épis dorés. Tousello a cambo roujo : touselle dont la tige se colore en rouge après la floraison. Es la pasto de tousello : c’est cela qu’il y a de meilleur.
On pourrait s’arrêter là mais la curiosité aidant, cette touzelle est présente dans toute la littérature « agricole » du Sud-Est, depuis très longtemps, apportée semble-t-il par la domination romaine (viendrait du latin tonsus – tondu – variété sans barbe) et, de l’avis de tous, un des meilleurs blés qui soit.
| BLÉ ROUGE DE PROVENCE Touzelle rouge. D’hiver et de printemps, mieux de février sous le climat de Paris. Paille blanche, de hauteur moyenne, souple, un peu faible. Épi aplati, assez long, d’un rouge très foncé, presque violacé ; épillets en éventail à glumelles longues et pointues. Grain rouge, long, effilé, demi-glacé, de qualité supérieure. Le blé rouge de Provence est une de nos bonnes variétés méridionales indigènes. Un peu trop délicat pour le climat de Paris où il ne réussit bien qu’exceptionnellement, il donne en Provence et en Languedoc un produit remarquable par son abondance et surtout par sa qualité. Sans être très difficile sur la nature du sol, il préfère les terres saines, perméables et abondamment pourvues de calcaire. On le sème de préférence à l’automne, bien qu’il puisse également réussir comme blé de printemps. Quoique dépourvu de barbes, il a l’avantage de ne pas s’égrener sous l’action du vent. Vilmorin-Andrieu (1880) Les meilleurs blés du Sud-Est |

|
Dans l’Histoire de Nîmes de Léon Ménard (1755), celui-ci rapporte qu’en 1330 « … à la suite d’un changement de monnaie dans les taux mis aux vivres et denrées par la Cour royale de Nîmes, le blé froment est fixé à six sols six deniers le sétier et pour la touzelle – nom que l’on donne sans le pays au plus beau et plus pur froment – à sept sols le sétier. »
Le même Léon Ménard (tome 4) nous dit qu’en 1482, le roi Louis XI étant tombé malade à Tours, fit voiturer quatroze salmées, sur quatorze mulets, de blé de Nîmes « pour en faire le pain destiné pour sa bouche. » Ce prince, affaibli d’esprit et de corps et frappé de la crainte de la mort, pensait que de tous les blés du royaume, la touzelle était « le blé le plus propre à lui donner la santé. »
J’ai vérifié, et me dois de vous dire qu’il est mort quand même l’année suivante… (août 1483). La touselle est magnifique mais pas miraculeuse…

Olivier de Serres (Théâtre d’agriculture et mesnage des champs), ancètre reconnu de l’agronomie, nous redit en 1600 : « Les italiens, les piémontais, ceux de la Provence s’accordent à ce mot, toselle, qui est un froment ras, prisé par sur (= dessus) tout autre pour la délicatesse de son pain. »
Enfin, le dictionnaire étymologique de la langue d’oc reprend le « Manuscrit de Seguier » (Je n’en ai pas trouva trace…) et nous cite la page 41 : « Touselle ‘lou blad lou pu pesant, lou pu beu, lou millou et aquel que fait lou pan lou pu blanc .’ »
D’après ce même dictionnaire, le mot a été importé en français par Rabelais (qui, ayant fait ses études à Montpellier, était familier de l’occitan). Dans le Quart livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel : « Cestuy home caché dedans le benoitier, aroyt un champ grand et restile, et le semoyt de touzelle. »
Puisque nous en sommes aux références littéraires, Jean de La Fontaine utilise ce mot dans Le diable de Papefiguière.
Le Manant dit : « Monseigneur, pour le mieux,
Je crois qu’il faut les couvrir de touselle,
Car c’est un grain qui vient fort aisément.
— Je ne connais ce grain-là nullement,
Dit le Lutin. Comment dis-tu ?… Touselle ?…
Mémoire n’ai d’aucun grain qui s’appelle
De cette sorte ! Or emplis-en ce lieu :
Touselle soit, touselle, de par Dieu ! »
Ceci dit, La Fontaine, interrogé par Richelet (qui établissait son Dictionnaire du Francois en 1680) sur le sens du mot, a avoué qu’il ne savait pas ce que c’était !
Sandy Andriant me dit que dans les Registres du Conseil Général de la Communauté de Séderon déjà en 1612 il est fait mention de « blé annone ».
Voulant savoir si ce blé annone avait un rapport avec notre Touzelle, blé rouge de Séderon, Vilmorin-Andrieu in Les meilleurs blés (1880) me répond :

« La touzelle anone est très anciennement cultivée dans le midi de la France, en Provence surtout et son nom semblerait indiquer qu’elle date de la domination romaine ; cependant elle est devenue assez rare aujourd’hui…
Le produit en grain en est bon et en paille il est considérable ; elle convient bien aux terres légères et donne un rendement passable dans celles même qui sont assez médiocres, la maturité en est remarquable ; elle peut rendre de vrais services, soit pure, soit en mélange avec d’autres variétés et il serait fâcheux qu’elle fut entièrement perdue. »
Vilmorin ajoute que c’est probablement du blé rouge de Provence. Donc on peut penser sans abus que c’était déjà du blé rouge de Séderon.
Pour être plus complet, il s’est créé en 2005, un Syndicat de Promotion Touselle, afin de sauvegarder et promouvoir les variétés anciennes. Grâce au Conservatoire de l’INRA de Clermont-Ferrant qui avait encore des semences de 13 variétés de touzelle, des paysans du Gard, Vaucluse, Haute-Provence… ont mis en place des parcelles expérimentales.
D’autant que d’après les spécialistes, cette touzelle ne contient que 7 % de gluten, là où nos blés modernes doivent en contenir au moins 12 % ; ce qui n’est pas bon pour les organismes délicats de nos contemporains !
J’ajouterai pour mémoire que jusqu’en 1930, il y a eu à Forcalquier une « Minoterie des Touzelles », dont le dernier propriétaire était Élie Tourniaire (Archives Départementales de Digne).
J’espère que votre fierté d’être séderonnais est, comme la mienne sortie grandie de cette découverte capitale.
Je ne trouve meilleure conclusion, en pensant à certains lecteurs, que celle de Mistral dans Mirèio :
| E’n ribéjant long di tousello
Que, sout lou vènt que li bacello, Oundejon à grands erso : « O moun Diéu ! li bèu blad ! Quenti blad drud ! fasien en troupo. Aco sara de bello coupo ! Vès ! coume l’auro lis estoupo, E peréu coume en l’èr soun lèu mai regibla ! » |
En longeant les touselles
Qui sous le vent qui les frappent Ondoient en grandes vagues : « O mon Dieu ! les beaux blés ! Quels blés drus ! faisaient-ils en chœur. Ce sera beau àcouper ! Voyez comme le vent les retrousse, Et aussi comme ils se redressent vite ! |