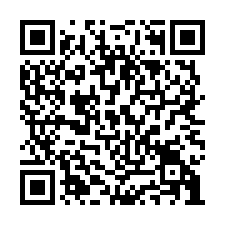L’emplacement de l’actuelle salle des fêtes de Séderon est avant la Révolution occupé par un four banal. Ce four à cuire le pain d’usage collectif est ainsi nommé parce que le seigneur de Séderon, son propriétaire, oblige les habitants de son fief, en vertu de son droit de ban (droit de commander et de contraindre), à l’utiliser en contrepartie d’une redevance perpétuelle, fixée à l’origine à 1 pain tous les 60 pains cuits puis convertie en un abonnement sous la forme d’une rente féodale annuelle en avoine (5 charges d’une ânesse, soit environ 640 kg), plus utilisable par le seigneur et plus prévisible pour la Communauté de Séderon. Depuis le début du XVIIIème siècle, certains des habitants des écarts ont cependant construit par commodité des fours individuels dans leur habitation, mais ils ont dû pour cela recevoir l’autorisation du seigneur.
Le four banal ayant été démoli vers le milieu du XIXe siècle, les lignes qui suivent tentent, à l’aide de documents trouvés dans les archives, de faire revivre cet équipement collectif qui devait être d’une grande importance dans la vie quotidienne des Séderonnais d’Ancien Régime. Les expressions tirées de ces documents d’archives sont reproduites ici en italique gras .
Le four banal est la propriété du seigneur de Séderon qui l’a sans doute fait construire vers la fin du XVe siècle, c’est-à-dire à une époque où la limite Sud du village ne dépassait sans doute pas ce niveau (cette situation en dehors des habitations permettant de réduire les risques d’incendie).
Le four banal est à l’origine constitué d’une voûte ouvrant sur la Grand Rue et occupée dans le fond par le four proprement dit. L’aspect originel du four banal est schématisé sur la figure suivante inspirée de vues de fours banaux actuellement restaurés dans le Sud-Est de la France.

En accord avec le seigneur la Communauté a sans doute très tôt aménagé un toit sur le four et a pu se rendre ainsi propriétaire du galetas au dessus du four (en 1612, elle achète des tuiles pour réparer le toit du four). En 1708, la Communauté fait fermer la voûte du coté de la Grand Rue par une muraille . Elle en profite pour jeter un plancher au dessus de la voûte et aménager le galetas au dessus du four en un étage (la chambre du four ) où pourra se réunir son Conseil Général (assemblée de tous les chefs de famille) et qui pourra servir de salle de classe pour les enfants des écoles (et ainsi économiser la location du local qu’elle devait fournir au maître d’école).
Le gros des travaux semble terminé à la fin de 1711 (l’annotation premier conseil tenu dans la maison commune figure dans la marge du compte rendu de la délibération du Conseil Général du 13 décembre 1711). A l’arrière du bâtiment se trouve une cour de plain-pied avec le plancher de la chambre du four et qui correspond au vide actuel en bordure de la Rosière.
Le partage de la propriété du bâtiment du four banal entre la Communauté et le seigneur est précisé en 1792 quand les experts chargés de l’inventaire des biens nobles déclarent qu’au four la seule voute a toujours été crue appartenir au seigneur, le reste du bâtiment à la commune (dans une convention passée en 1767 par le seigneur, il est rappelé que celui-ci ne doit faire entretenir que le sol et la voute du four).
De 1711 jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’aspect du four banal ne changera pratiquement plus (d’après un devis datant de cette époque, l’emplacement du four banal correspond à un rectangle de 6 m de large sur 9 m de long et la cour arrière à un rectangle de 6 m de large sur 4 m de long).
Avec le développement du village vers le Sud, le four banal s’est rapidement trouvé à mi-hauteur de la Grand Rue et il est sans doute devenu la limite entre le vieux et le nouveau village. Ce partage en deux du village apparaît en 1628 quand la Communauté décide de répartir les habitants en deux groupes chargés de prévenir la propagation dans le village d’une épidémie de peste ( ceux despuis le four au bas pour surveiller son entrée Nord, et ceux despuis le four en haut pour surveiller son entrée Sud). Pourquoi alors ne pas supposer que le four banal est à l’origine de la limite que récemment encore ne dépassaient que rarement, vers le haut ou vers le bas, quelques irréductibles gens d’en bas ou gens d’en haut .
En négociant la rente féodale en avoine, la Communauté s’est sans doute engagée vis-à-vis du seigneur à assurer le bon fonctionnement du four. Elle le fait exploiter par deux fourniers et s’assure du versement au seigneur de la rente en avoine. C’est sans doute pour faciliter cette exploitation qu’elle s’est rendue propriétaire du galetas au dessus du four .
Après mise aux enchères publiques, l’exploitation du four banal est affermée chaque année à la Saint Michel (la fête de ce saint le 29 septembre marque la fin des récoltes et de ce fait ce jour est traditionnellement celui de la passation des baux). Les deux fourniers retenus sont ceux qui s’engagent à reverser à la Communauté une quantité de bonne et belle avoine qui contribue au mieux à la rente féodale. Le bail est passé par les consuls (les deux administrateurs de la Communauté élus chaque année par le Conseil Général), sous l’agrément du fermier du seigneur (l’agent du seigneur chargé de collecter ses redevances). Les fourniers semblent exercer leur fonction en alternance car, dans les baux, leurs obligations sont mentionnées globalement puis détaillées pour le chacun .
En contrepartie d’une rétribution égale au droit de cuisson du seigneur (1 pain pour 60 pains cuits), les fourniers s’engagent à chauffer le four et à cuire le pain en paste des habitants en bons pères de famille . Ils sont tenus d’avertir les habitants quand le four sera en estat de cuire de façon que la paste ne se gate dans le pétrin et mesme estant au four . Etant rétribués en nature, les fourniers ont intérêt à ce que leur prestation soit soignée mais le bail précise quand même que dans le cas que lesdits fourniers laisseroient gater le pain de quelqu’un des habitants par leur défaut, ils s’obligent de le leur payer à l’estimation d’experts . Par ailleurs, pour prélever leur rétribution les fourniers doivent prendre le pain qui viendra après le cinquante neuvième sans pouvoir autrement choisir .
Le diamètre de la voute du four banal (environ 6 m) laisse supposer que le four proprement dit est de forte capacité et peut en une seule fournée journalière satisfaire la demande de nombreux habitants (au milieu du XIXe siècle, le bâtiment du four banal est appelé le Grand Four ).
Le pain apporté au four banal est préparé à la maison par les ménagères séderonnaises. Elles pétrissent elles-mêmes leur pain dans des pétrins domestiques appelés mées (du provençal mastra) et le portent au four sur des tables , planches munies de rebords encore utilisées actuellement par les boulangers (le mot provençal taula désigne aussi bien une table qu’une planche). Ces meubles font partie de tous les inventaires de mobilier établis à la fin de l’Ancien Régime par le notaire de Séderon. Les pétrins sont le plus souvent en noyer et les tables en bois blanc.
Le nombre de tables possédées par chaque foyer (environ 2) correspond sans doute à la capacité en pains des pétrins.
Le pain consommé à cette époque est principalement de counsegau (nom provençal du méteil, mélange de seigle et de froment semés et récoltés ensemble). La farine provenant du moulin n’est pas débarrassée du son et les Séderonnaises avant de l’employer dans leur pétrin doivent la tamiser à l’aide du crible qui figure également dans presque tous les inventaires de mobilier domestique.
La préparation domestique du pain et l’utilisation collective du four supposent la constitution d’une réserve familiale qui ne pouvait être renouvelée qu’un nombre de fois limité dans l’année. Le pain, stocké dans le pétrin, est donc le plus souvent consommé rassis, même si sa fabrication à partir de conseguau et son façonnage en grosses miches lui permettent de sécher moins vite (dans un contrat de 1693 le pain doit être fourni en miche de 3 kg). Des tailles-pain , certainement utilisé quand le pain est trop dur, figurent aussi dans de nombreux inventaires de mobilier domestique.
L’usage veut que, les cuissons du pain journalières étant terminées, le four banal encore chaud puisse être utilisé par les habitants pour la cuisson au four de certaines préparations culinaires. Aux termes de leurs baux passés avec les consuls, les fourniers de Séderon sont ainsi tenus de laisser cuire gratuitement les pannayes et les thians des habitants ( pannayes et thian sont des mots du patois gavot qui sont encore utilisés aujourd’hui pour désigner les tartes et les gratins). Cependant cet usage gratuit du four est limité à deux pièces de pannaye et de thian par jour et les Séderonnais qui dépassent cette limite (principalement les aubergistes) sont tenus de payer au fournier 3 deniers par pièce supplémentaire.
L’approvisionnement du four en bois de chauffage constitue sans doute l’activité principale des fourniers (en 1778, la Communauté leur prête 42 livres afin d’acheter une bourrique pour les aider dans cette tâche). Il est sous la surveillance étroite des consuls afin qu’il ne prive pas les habitants d’une partie de leurs besoins en bois de chauffage. Les fourniers risquent 5 livres d’amende applicables à l’Hopital (l’organisme de charité de la Communauté) s’ils prennent du bois en dehors des endroits que les habitants ont droit d’en prendre . Pour réduire cet approvisionnement en bois, les consuls s’assurent auprès des fourniers du bon état de fonctionnement du four et interviennent auprès du seigneur pour que celui-ci prenne en charge les réparations nécessaires. Ainsi en 1692, les consuls se rendent à Murs pour signaler au seigneur de Séderon de l’époque (Jean d’Astuard) que le four est en état de périr et le prier d’ordonner de le faire réparer et le mettre en état que ne sy gatte le pain et qu’il ne consume une prodigieuse quantité de bois . La surveillance de l’approvisionnement en bois par les consuls va jusqu’à la prévention d’éventuels trafics (une amende de 20 sols est appliquée aux fourniers toutes les fois qu’ils font charrier autre bois que pour l’utilité du four ).
Un hangar est aménagé dans la cour arrière du bâtiment du four. Les fourniers y mettent en réserve leur provision de bois et ils sont tenus de décharger le bois en toute saison à la porte de la Rosière (l’accès à la cour arrière par la Rosière) pour ne troubler le passage de la rue .
Les baux du four comportent également des clauses relatives à la propreté du four (les fourniers doivent tenir la rue nette au devant du four sans doute après avoir déchargé les cendres) et à son entretien (les fourniers doivent nettoyer de temps en temps le canon de la cheminée en sorte que le feu ne s’y mette ).
La chambre du four est traversée par la cheminée du four, ce qui lui procure l’avantage d’être chauffée pendant la saison froide, et dans leur bail passé avec la Communauté les fourniers sont tenus de fournir des fagots de bois lorsque le Conseil Général s’assemblera et que le froid le requerra .
Pendant les cuissons en période de froid, le local du four devait être un endroit agréable où certains oisifs séderonnais devaient se rassembler. Aussi le valet de ville (garde champêtre de l’époque) est chargé par les consuls d’empêcher autre personne que celles qui cuiront d’entrer au four pour empêcher les abus qui s’y commet et qui donnent lieu à la fénéantise .
Généralement le bail du four est renouvelé pendant un certain temps avec les mêmes petits propriétaires séderonnais. La fonction de fournier devait constituer une ressource d’appoint pour ces Séderonnais défavorisés mais elle devait exiger d’eux une certaine expérience.
En 1699 c’est une veuve séderonnaise qui remplit la fonction de fournier mais celle-ci, ayant des difficultés pour payer la contribution à la rente féodale, propose aux consuls de garder gratuitement les pourceaux des habitants.
La rétribution des deux fourniers apparaît relativement modeste si elle ne se base que sur le pain cuit pour l’alimentation des quelques 110 familles qui habitent dans le village à l’époque (les deux fourniers ne gagnent alors que la quantité de pain tout juste nécessaire à l’alimentation de leur propre famille). Mais les fourniers font certainement cuire plus de pain pour les revendeurs de pain .
La fabrication du pain dans le but de le revendre est une activité sans doute pratiquée à Séderon par certains boutiquiers qui pétrissent leur propre farine dans des quantités qui dépassent leurs besoins personnels pour fournir ceux qui font logement (les aubergistes) et les habitants qui n’ont pas de quoi avoir du bled pour faire provision de pain et qui peuvent avoir quelques sous pour y être employé . Il existe aussi des boulangers c’est-à-dire sans doute des habitants qui pétrissent la farine que leur apportent d’autres habitants (l’artisan Pierre-André Pellegrin, qualifié en 1782 de boulanger, devait exercer cette activité en plus de son métier de cordonnier). Font aussi partie des revendeurs de pain les fourniers qui peuvent ainsi écouler la quantité de pains cuits prélevés qui dépasse leur besoins personnels. Les prix pratiqués par ces différents revendeurs de pain devaient être le sujet de nombreuses discussions (une mise aux enchères est organisée en 1678 pour délivrer à un panetier le monopole de la revente du pain à un prix fixé).
A la fin de l’Ancien Régime, il semble que les fourniers aient des difficultés à payer leur contribution à la rente féodale. Entre 1769 et 1775, la contribution reste plafonnée à 640 kg d’avoine pendant 4 ans mais pendant les 3 autres années elle est inférieure. C’est alors la Communauté qui se charge de la quantité d’avoine en reste (en 1773, les fourniers n’ont versé que 448 kg et c’est la Communauté qui verse au fermier du seigneur le prix des 192 kg restants). La difficulté de payer la contribution est sans doute la cause de l’absence de bail en 1776 car à partir de 1777 la contribution en avoine disparaît et le bail n’est plus passé par les consuls après avoir fait procéder aux enchères et criées (annonces des enchères) mais directement par les consuls de leur gré pour et au nom de la communauté . A partir de 1778 les enchères sont de nouveau pratiquées mais le bail est accordé aux fourniers qui ne sous-enchérissent pas la rétribution de 1 pain pour 60 pains cuits. A partir de 1777 et jusqu’à la Révolution la rente en avoine est prise en charge chaque année par la Communauté.
Les droits féodaux sont supprimés dans la nuit du 4 août 1789 et le 22 novembre 1790, le bail passé avec les fourniers ne fait référence qu’au four. Sans autres formalités, le four banal est apparemment devenu four communal. Ce four communal semble être utilisé jusqu’aux années 1840 (2 fourniers figurent dans le recensement de 1841), mais en 1847, faute de réparations, le four communal se trouve dans l’inaction depuis longtemps . En 1866 le four est démoli et son emplacement transformé en une assez vaste salle proposée comme salle d’audience pour la justice de paix mais qui ne sera utilisée que comme écurie, louée par la Commune, jusqu’à sa transformation définitive en salle des fêtes en 1928. Entre temps les boulangers d’Ancien Régime sont devenus les boulangers modernes en équipant leur habitation d’un four à usage commercial.